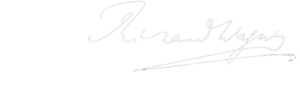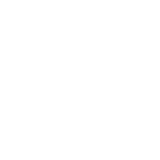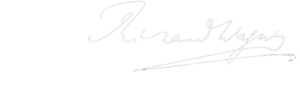
Fort du recul objectif procuré par les quelques semaines qui me séparent de mon séjour, cet été, à Bayreuth, cité lyrique où je n’étais plus retourné depuis bientôt dix ans, il me semblait utile de revenir en quelques paragraphes sur mes impressions, davantage ici esthétiques que musicales, et mettre en évidence un certain nombre de points concernant la cuvée 2025 de l’un des festivals les plus prestigieux au monde.
Disons-le tout net : est désormais derrière nous la période d’incertitude artistique dans laquelle, il y a quelques années, nous avions eu le sentiment que la vénérable manifestation bavaroise s’enfonçait de plus en plus, et dont les visions pas plus enchanteresses que pédagogiques – malgré, par-ci par-là, d’éventuelles qualités intrinsèques – totalement inféodées à ce qui était devenu une idéologie « Regietheater » ont tant contribué, selon nous, à faire déserter de la colline verte bon nombre de wagnériens du monde entier, et de France en particulier.

©Enrico Nawrath
N’en déplaise à certains critiques et à une certaine forme de snobisme culturel, je n’avais personnellement que très peu goûté les partis-pris pauvrement déconstructionnistes, pseudo politico-sociologiques voire les consultations psychanalytiques – pour ne pas dire psychiatriques ! – auxquelles m’avait contraint d’assister – et pas gratuitement ! – un Sebastian Baumgarten pour Tannhäuser (vu en 2011), une Katharina Wagner pour Tristan und Isolde (vu en 2016) ou même un Hans Neuenfels pour Lohengrin (Ratten-Lohengrin ou Lohengrin chez les rats tel que le qualifia alors la presse allemande…) (vu en 2011), malgré pour ce dernier une dimension esthétique que l’on ne peut évidemment limiter aux seuls choristes vêtus en rats… .

©Enrico Nawrath
A vrai dire, le seul moment resté gravé à mon esprit, dans ce passé récent, demeurait jusqu’à ce jour le Parsifal selon Stefan Herheim (vu en 2012), metteur en scène issu pourtant du Regietheater mais ne confondant pas lecture du Monde – jusqu’au plus contemporain – et volonté creuse de déconstruire ou de choquer !
J’ai cependant pleinement conscience que mon propos, forcément subjectif, gagnerait en vision globale si j’avais pu voir sur scène les productions incontournables – pour un tas de raisons que la critique spécialisée a souvent bien documentées – des Meistersinger von Nürnberg par Katharina Wagner donnés de 2007 à 2011 puis par Barrie Kosky (2017-21), de Tannhäuser par Tobias Kratzer (2019-2024) et, bien sûr, du Ring selon Frank Castorf (2013-17), autant de spectacles régulièrement remis sur le métier, selon le mode opératoire, si consubstantiel au Festspielhaus, du Werkstatt – littéralement, de « l’Atelier » – permettant à une production à l’affiche sur la colline verte de se polir au fil des étés. Las, j’ai du me contenter de voir et revoir les DVD1… .

©Enrico Nawrath
Le retour de l’exigence esthétique dans la programmation du Festspielhaus :
Si l’on fait exception de l’impossible vision de Valentin Schwarz pour Der Ring des Nibelungen, encore à l’affiche cette année et auquel j’ai délibérément souhaité ne pas assister, les quatre opus programmés – Parsifal, Lohengrin, Tristan und Isolde et Die Meistersinger von Nürnberg – témoignent, malgré un certain nombre de passages à vide déjà relevés par la critique internationale, d’un retour à une exigence esthétique qui redonne confiance en l’avenir de la manifestation.
De fait, j’ai trouvé que le souci permanent des scénographes réunis pour ces quatre ouvrages avait été de conserver un esprit de lisibilité globale des œuvres et de permettre au spectateur de comprendre ce qui se passait sur scène sans avoir besoin d’être féru en géopolitique internationale, en sociologie des organisations ou en histoire de l’Allemagne des origines à nos jours… !

©Enrico Nawrath
Même dans la mise en scène assez terne et bien-pensante de Parsifal selon l’américain Jay Scheib – avec ou sans lunettes de réalité augmentée ! – les décors de Mimi Lien et les costumes de Meentje Nielsen imposent une esthétique qui, sans aller très loin dans le sens de cet opéra si singulier, nous réservent quelques moments bienvenus comme la scène des filles-fleurs, plus sauvages qu’à l’habitude dans leur art de dépecer du chevalier, certes inspirées du Jardin des délices de Jérôme Bosch mais presque droites sorties, pour nous, d’une vision cinématographique alla Fellini.
Du Rattengrin de Hans Neuenfels au Lohengrin de Yuval Sharon, hésitant entre tradition des contes et regard sur le monde actuel, on garde la – bonne – idée de la complexité qui se dissimule derrière la vision simpliste des « gentils » (Lohengrin/Elsa) et des « méchants » (Telramund/Ortrud). Dans une scénographie assez impressionnante des plasticiens Rosa Loy et Neo Rauch – avec ciel, nuages, architecture faite de poteaux électriques, transformateur géant qui deviendra cathédrale à la fin de l’acte II, tour-phare d’Elsa au milieu d’une nature maritime bluffante – il revient donc au chevalier au cygne – qui apparaît bien sur scène, au premier acte, n’en déplaise à certains critiques qui ont fait mine de ne pas le voir ! – d’apporter la lumière et de, finalement, la confier à Elsa, mettant ainsi fin à des temps d’obscurantisme où les bûchers et les bourreaux faisaient leur œuvre sur plusieurs types de femme : les « immaculées » (Elsa ?) comme les plus « sombres » (Ortrud ?), toutes se sauvant in extremis… du moins dans la lecture de Yuval Sharon.
Cette même lumière, si crépusculaire dans la vision que donnent de Tristan und Isolde le metteur en scène islandais Thorleifur Örn Arnarsson et son éclairagiste Sascha Zauner, dans un spectacle d’une rare force où les bougies de cérémonie occultiste ne font pas oublier la nuit qui entoure tous les personnages, se verra magnifiée par les éclairages à la fois too much et poétiques de Fabrice Kebour pour Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, vus par le metteur en scène Matthias Davids, habitué du monde des comédies musicales. Dans ce dernier spectacle, les décors alla Broadway signés Andrew D. Edwards impressionnent par leur liberté grandiosement kitsch, pas du tout incohérente dans le contexte de la Festwiese de la fin du troisième acte. On en prend plein les yeux, et pour notre plus grand plaisir !

©Enrico Nawrath
Car ce sont précisément ces jeux d’ombre et de lumière, d’une inspiration finalement très Neues Bayreuth, qui constituent un des traits les plus marquants de ce retour d’une exigence esthétique au sein du temple wagnérien. L’abstraction et la simplicité des lignes renouent ainsi avec ce qui fit, longtemps, la réputation unique du lieu et que l’on n’avait pas toujours réussi à percevoir dans les productions auxquelles il nous avait été donné d’assister. Du prélude de Parsifal, avec sa vision d’un ciel crépusculaire et tourmenté – signé Rainer Casper, récemment disparu – aux couleurs mordorées de Tristan en passant par la palette des bleus de Lohengrin – en particulier dans le cyclorama du début du deuxième acte ! -, l’œil trouve souvent l’occasion d’être ré-enchanté et c’est bien légitime vu le lieu inspiré où l’on se trouve !

©Enrico Nawrath
De même, les symboles et visions scéniques si consubstantiellement associés à la geste wagnérienne – la forêt, la lance et l’eau du lac dans Parsifal, le cérémonial du « jugement de Dieu » et la présence de l’épée dans Lohengrin, la nef et les voiles du navire dans Tristan, la rue de Nuremberg et la Festwiese avec sa scène en forme circulaire et son ciel bleu en fond de scène, au début du troisième acte des Maîtres – sont bel et bien de retour dans des productions qui n’ont pourtant rien de passéistes ni de muséales : cette continuité, de nouveau assumée, permet ainsi, pour un nouveau public, d’ancrer les ouvrages dans une filiation claire sans pour autant les figer dans le passé. Ainsi, si l’on a droit, avec Yuval Sharon, à la préparation précise de l’espace terrestre du combat entre Lohengrin et Telramund, c’est finalement dans les airs que celui-ci se déroule, dans une étonnante scène digne de la saga des Harry Potter !

©Enrico Nawrath
A l’occasion, les clins d’œil à la « tradition » wielandienne et wolfgangienne2 se signalent aux plus avertis, comme lorsqu’apparaît ce disque circulaire qui se surélève et semble flotter au-dessus du sol environnant au moment de la cérémonie du Graal ou lorsque la liturgie explicite de la fin du premier acte de Parsifal se déroule dans un mouvement contenu des corps. Ailleurs, c’est ce phare d’où Elsa entend l’appel plaintif d’Ortrud qui nous rappelle la tourelle gothique chère à la production de Wieland Wagner pour Lohengrin. Pour prendre un dernier exemple, ô combien symbolique, c’est bien sûr la robe d’Isolde (créée par Sibylle Wallum), magnifiquement portée par la superbe Camilla Nylund au premier acte de Tristan, qui va chercher son inspiration directe dans le large manteau endossé par Johanna Meier dans la mise en scène de Jean Pierre Ponnelle, ici même en 1981.

©DR
La notion de mystère, si souvent négligée au profit de lectures trop conceptuelles – comme le Regietheater en a si longtemps raffolé – fait également un retour remarqué à Bayreuth. Ainsi, les atmosphères nocturnes, les tonalités gothiques et romantiques (Ah, ce début de deuxième acte de Lohengrin qui nous renvoie aux contes de Grimm voire à la Rebecca d’Hitchcock et cette cale de navire du deuxième acte de Tristan und Isolde plus proche, pour nous, d’un cabinet de curiosités de mécène décadent que d’un épisode de Louis la brocante, comme on a pu parfois le lire !) restituent aux œuvres au programme cette part d’ambiguïté et de poésie qui continuent à nous accompagner, une fois la représentation terminée. Retrouver du mystère, au-delà de la configuration unique de cette salle plongée dans l’obscurité avant que le premier accord ne s’élève, n’aura pas été le moindre de mes coups de cœur du Bayreuth 2025 !

J’ai évoqué plus haut, comme clin d’œil adressé aux aficionados de toujours, la référence au manteau d’Isolde conçu par Jean-Pierre Ponnelle et vu aujourd’hui par Thorleifur Örn Arnarsson mais, d’une façon générale, la beauté des costumes aura également constitué un autre point fort de cette édition. Inspirés de références picturales empruntées, pour Lohengrin, à l’imagerie hollandaise des toiles d’un Rembrandt ou d’un Van Dyck, ils donnent à voir, dans Les Maîtres Chanteurs, un feu d’artifice de couleurs allant du plus classique – l’assemblée des fidèles lors de la scène introductive dans l’église Ste Catherine, les maîtres revêtus des capes de cérémonie avec colliers de leur ordre et bonnets phrygiens – au plus actuel, avec un Walther à la chemise aux papillons et un Beckmesser, rockeur au luth électrique en forme de cœur !

Dans l’imaginaire de beaucoup – même de celles et ceux qui n’ont pas eu la chance d’y aller ! – Bayreuth, c’est la force de frappe d’un ensemble choral d’exception. Malgré les coupes budgétaires qui, ici comme ailleurs, ont affecté les recrutements – en particulier, pour Les Maîtres Chanteurs -, les effectifs, dirigés par l’excellent Thomas Eitler de Lint, nous auront gratifiés de performances de haute voltige. En outre, leur traitement scénique, parfois chorégraphié comme dans Les Maîtres, s’avère également remarquable et apporte une énergie nouvelle bienvenue.

Sans rajouter un énième compte-rendu à ceux qui ont fleuri sur le net ces dernières semaines, j’ai trouvé les prises de position de certains des metteurs en scène, à l’affiche cet été, particulièrement pertinentes par leur lisibilité. Avec Matthias Davids, nouveau venu sur la colline, il est passionnant de pénétrer dans la psychologie d’un Hans Sachs, ici pas si débonnaire voire même souvent colérique et d’un Beckmesser pas si antipathique ni ridicule : La dernière scène voit d’ailleurs les deux hommes, en fond de scène, continuer à débattre autour de la question des paroles du lied, redonnant, peut-être, une chance au Collectif et à l’esprit de Communauté (la notion de Gemeinschaft chère à la science politique allemande et à Ferdinand Tönnies), à moins qu’ils ne s’enferment, malheureux, dans le respect d’un rituel rabougri et d’une tradition désormais à bout de souffle (?) face à l’individualisme de Walther et d’Eva…qui, eux, comme l’Elsa de Yuval Sharon, choisissent de continuer leur vie ailleurs, loin des contraintes… et des chevaliers possessifs !

Les fameuses « blondes wagnériennes » (Elsa, Eva) sont, une fois pour toutes, devenues – ou deviennent au cours du spectacle – des « femmes puissantes » qui n’hésitent pas à faire leur valise ou, dans le cas d’Elsa, leur sac à dos avec un plein d’énergie à l’intérieur.
Je voudrais terminer ces quelques impressions par la grande « nouveauté » constituée par la volonté manifeste de replacer la musique au centre de l’œuvre d’art totale, telle que Bayreuth a souhaité la magnifier. En écrivant cela, j’ai évidemment conscience que le projet même du Festspielhaus impliquait de faire disparaître la visibilité de l’orchestre pour donner au « festival scénique » toute sa nouvelle place : c’est, entre autres choses, ce qui fait courir les wagnériens au théâtre des festivals depuis bientôt cent-cinquante ans ! Mais, cela ne signifie pas pour autant que la musique, seule, ne puisse pas conserver ses droits et qu’il faille à tout prix « tout » mettre en scène, de la première note à l’accord final ! Les préludes joués rideau baissé m’ont ainsi, personnellement, permis de me concentrer sur le surgissement du son dans « ce » théâtre – qui n’a rien de commun avec aucun autre au monde ! – et de permettre à l’œil… d’écouter. Quel soulagement, parfois !
Alors, puisque Bayreuth, qui est toujours parvenu à se renouveler, à décider de (re)prendre cette voie, je crois que l’on pourra, dans les prochains étés, gravir plus volontiers la Siegfried Wagner Allee vers l’éternellement mythique Grüner Hügel !!
Hervé Casini
1 Curieusement inexistant d’ailleurs pour Le Ring de Castorf alors que les caméras étaient bien présentes dans la salle, en 2016, et que la diffusion à la télévision allemande a été, un moment, disponible sur Sky… mystère.
2 Héritée donc des mises en scène des Wagner : Wieland (1917-1966) et Wolfgang (1919-2010).