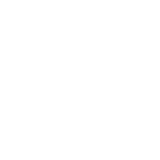L’opéra à la fois le plus ambitieux, le plus colossal, le plus lourd, le plus exigeant et – last but not least – le plus complexe du génial compositeur munichois, aura donc attendu au-delà d’un siècle avant de connaître enfin sa création lyonnaise. Si nous honorons un évènement que l’on n’espérait plus, il convient de s’interroger sur les raisons de cette navrante carence. En effet, quand Arabella ou Daphne (pour ne choisir que deux exemples, dans deux styles différents) restent ignorés jusqu’à présent entre Saône et Rhône, nous le devons plutôt à l’impéritie de la majorité des directeurs qui s’y sont succédé. En revanche, Die Frau ohne Schatten [La Femme sans ombre] pose des problèmes de dimensions qui ne pouvaient que bloquer toute entreprise. Au premier chef, la taille de l’orchestre requis. Record absolu de Strauss à l’opéra [125 instrumentistes contre 111 pour Elektra], la tablature dépasse les capacités de la fosse d’ici (soit la plus sidérante supercherie du sieur Jean Nouvel, que nous dénoncions dès 1993).
Par trois fois pour Elektra, le Théâtre antique de Fourvière (1963 et 1997), puis, une habile scénographie plaçant la phalange sur scène (2017), constituèrent des expédients plausibles.
Allons droit au but : pour Die Frau ohne Schatten la solution idéale eût été la mise en espace et en lumières à l’Auditorium. Au lieu de cela, la discutable option retenue consiste à utiliser une réduction d’orchestre, réalisée dès 2022 chez Schott Music par l’arrangeur Leonard Eröd.
Ce travail a beau être scrupuleux, il n’en demeure pas moins que, ramener l’instrumentarium à 76 pupitres produit des conséquences assez fâcheuses quant à la perception du capiteux flot sonore – ici fatalement endigué – présent dans l’édition originale. Toutefois, ce handicap passe au second plan, en raison d’une conception visuelle inopportunément réductrice.
Toute véritable dimension fantastique ou merveilleuse passe à la trappe
Car il faut une sacrée dose d’inconscience pour s’attaquer à un tel monument artistique, appartenant au patrimoine de l’Humanité, comme si l’on accomplissait une ordinaire fonction naturelle. Mariusz Treliński – Oh ! Quelle surprise !!! – nous fait, bien sûr, le coup banal de l’actualisation mais, sans doute dépourvu de faculté d’argumentation, laisse à son dramaturge le soin d’expliquer leur « vision » dans le programme de salle.
Une fois expédiée la partition de Strauss dans la phrase initiale, le sieur Marcin Cecko développe un discours amphigourique d’une rare cuistrerie, où il commence par rappeler combien l’intrigue du livret est « compliquée ». En réalité, elle s’avère seulement complexe et exige des scénographes aptes à éclairer le spectateur néophyte ! Nous vous épargnerons les développements indigestes de cette prose fumeuse, pour en arriver à son résultat synthétique vu en scène : l’Impératrice n’est qu’une femme souffrant de psychose maniaco-dépressive. Tout ce qu’expose le livret relève de ses seuls cauchemars ou fantasmes. Il faut vraiment ne pas manquer de souffle, de culot – voire d’arrogance – pour évacuer ainsi le génie poétique de Hugo von Hofmannsthal (implicitement perçu tel un oiseau rare), puis troquer tout ce qui constitue la grandeur du sujet contre un récit d’un affligeant prosaïsme, cultivant la désespérance.
Ainsi, l’essence d’un opéra initiatique grandiose, prolongeant Die Zauberflöte de Mozart et Parsifal de Wagner, fer de lance du symbolisme (qui, au visuel, eût été idéalement servi par un Gustav Klimt ; rêvons !), se trouve rabaissé au rang d’un médiocre opéra réaliste, ripoliné par un mauvais peintre expressionniste. Toute véritable dimension fantastique ou merveilleuse passe à la trappe pour ressasser, sempiternellement, notre affligeant « aujourd’hui », dont l’auditoire – pourtant écœuré par les drames de « notre temps » – aurait, à les croire, besoin pour se remonter le moral ! Voilà bien une démarche de nantis, éloignés de nos authentiques angoisses du quotidien. Gardons-nous de leur faire l’honneur de décrire le résultat de leurs divagations bouffies de suffisance : cette psychanalyse à deux balles relève du mille fois vu et revu.
Néanmoins, au bilan, que retenir de positif dans cette prétentieuse relecture désenchantée ? D’abord une direction d’acteurs où la plupart des gestes ou regards possèdent poids et valeur, sans gratuité (après six semaines de répétition, c’est bien le moins !). Ensuite, les lumières confiées à Marc Heinz, frisant la plus envoûtante magie. C’est assez pour éviter le naufrage d’une mise en scène qui tend à obscurcir la signification d’un indicible chef-d’œuvre, aboutissant à la forme la plus pernicieuse, insidieuse – voir perverse – de l’obscurantisme.
Un « Archibravo » à Daniele Rustioni comme à sa phalange
Le rapport d’expertise concernant l’exécution orchestrale nous incite maintenant à la prudence, dans la mesure où, connaissant bien le conducteur de la mouture originelle, nous n’avons encore jamais étudié celui de la réduction effectuée par Leonard Eröd. Bornons-nous donc aux impressions ressenties. Modifiant drastiquement la physionomie sonore, cette habile adaptation surexpose malgré tout les vents au détriment des cordes, souvent écrasées dans les tutti. Néanmoins, lors des passages les favorisant, ces dernières se révèlent stupéfiantes de pureté. Sans atteindre les sommets idiomatiques de leurs équivalents viennois ou munichois, voilà assurément un gage de leur implication. À des bois idéalement colorés, charismatiques, s’adjoignent des cuivres solides, assumant crânement un parcours exigeant, en endurance comme en foisonnement phonique. Au chapitre de la restitution des principaux leitmotivs, le résultat est plus mitigé : dès l’incipit, celui de Keikobad sonne fâcheusement grêle dans son énoncé. En revanche, ceux de la Pétrification, du Faucon ou du Jugement s’en tirent mieux, conservant leur indispensable solennité. Reste l’épineuse question des percussions. La suppression de certains instruments – tels que le Glasharmonika [harmonica de verre] – nous frustre par un manque induit d’associations de timbres propices aux sonorités irréelles.
Un autre problème dérangeant concerne les coupures. Certes, nous savons bien que, par le passé, mêmes des chefs tels que Karl Böhm, Joseph Keilberth ou Karajan en pratiquaient généralement trois dans l’acte III. Mais, depuis cinquante ans, la philologie s’impose, incitant tous les défenseurs de Die Frau ohne Schatten à restaurer l’intégralité du texte. Or, si l’Acte I demeure préservé dans son intégrité, nous notons ce soir – sauf erreur – cinq petites entailles dans le II et autant dans le III. Rien ne venant les justifier techniquement, nous soupçonnons fortement l’exigence fâcheusement intrusive des scénographes. L’on sent même le wokisme propager sa gangrène jusque dans le surtitrage où, par exemple, « Hündin ! » [« Chienne ! »] devient l’anodin « Misérable ! », lorsque le Messager des Esprits invective la Nourrice.
Tout le mérite en matière de cohésion dans un tel contexte revient à Daniele Rustioni. Pour son premier opéra de Strauss céans, notre Directeur musical aurait eu la partie plus aisée avec Ariadne auf Naxos, Salome, sinon Der Rosenkavalier. Qu’importe ! Sa fougue naturelle autant que sa bravoure et son implacable précision renversent tous les obstacles, tel Saint Georges combattant le dragon. Dominant glorieusement son sujet, il nous offre une interprétation singulière, jamais rude, toujours souple, empreinte d’un lyrisme fascinant, ne sombrant pas dans le piège commun à ceux qui tirent cette œuvre vers Schönberg ou Webern (ce qui nous a toujours semblé totalement incongru et la marque d’une méconnaissance absolue des intentions du compositeur bavarois).
Un « Archibravo » donc, au chef comme à sa phalange, qui nous communiquent même deux frissons mémorables : de terreur cosmique dans la conclusion de l’Acte II ; d’extase euphorisante dans celui du III.
Ajoutons à cela une irréprochable prestation des Chœurs, soigneusement préparés par Benedict Kearns, d’autant plus valeureux que toutes leurs interventions s’effectuent en voix « off« . Dames et messieurs se situent constamment dans la prestation de haute volée, en qualité de matériau autant qu’en minutie rythmique. Une mention pourtant à l’endroit des seconds, d’une poignante sensibilité dans l’intervention des Veilleurs « Ihr Gatten… » à la fin du I.
Une des meilleures distributions en solistes vocaux que nous ayons jamais entendue
Avec, pour Die Frau ohne Schatten, une dizaine de productions vues en direct à notre actif depuis 1980 (sans parler des écoutes en moult versions discographiques), affirmons-le sans ambages : voilà une des meilleures distributions en solistes vocaux que nous ayons jamais entendue… alors que le sort s’acharnait ! Le matin même, en moins de trente minutes d’écart, les interprètes du couple impérial affichés depuis la première déclaraient forfait : Sara Jakubiak à cause d’une forte toux ; Vincent Wolfsteiner atteint d’une infection de la gorge qui le rend aphone. Grâces soient rendues au Directeur de casting maison, Jochen Breiholz, qui parvient, en quelques heures, à faire venir in extremis – respectivement de Munich et Francfort – deux remplaçants parmi les rares titulaires possibles au monde, sauvant ainsi la représentation. Bel exploit ! Tandis que leurs confrères souffrants miment leurs rôles, Miriam Clark et Burkhard Fritz chantent au pupitre côté Cour. Comble du professionnalisme, la première, arrivée sur place la représentation entamée, s’immisce adroitement sur le simple marquage de sa consœur qui lui passe le relais.
Radieux jugendlich-dramatischer Sopran d’agilité (ce qu’est de facto l’Impératrice), engagée au-delà de toute espérance, Miriam Clark délivre une interprétation inouïe de justesse et de sentiment, jusqu’au contre-ré inclus ! Panachage inattendu de Hans Hopf et René Kollo (dans leurs qualités, sans leurs défauts), Burkhard Fritz excelle en projection, déployant une voix de ténor héroïque riche en harmoniques. Concerné et d’un élan impétueux, il domine sans effort apparent la tessiture meurtrière de l’Empereur, couronnée par un contre-ut souverain. Un régal de vaillance ! Vertu qui s’allie à la puissance et à la largeur chez la Teinturière d’Ambur Braid. Quel format ! Quel tempérament généreux ! Quel contrôle, aussi, dans la gestion de l’émission, n’appelant que louanges ! Rejoignant Dame Gwyneth Jones dans nos souvenirs, souhaitons que cette authentique grande soprano dramatique aux registres bien soudés gère avec prudence sa carrière (car elle donne tout, sans s’économiser), tant elle aura à nous offrir, chez Strauss, Wagner, Meyerbeer, Berlioz ou Puccini. Fort heureusement, elle bénéficie d’un partenaire à sa hauteur, en la personne de Josef Wagner, splendide baryton-basse qui campe un Barak pétri d’humanité autant que de noblesse naturelle. Fait stupéfiant : yeux fermés, l’on reste frappé par un mimétisme étonnant avec José van Dam question timbre. Rayonnant, suprêmement bien chantant (phrasé raffiné, quasi belcantiste, conduite de la ligne superlative, et quel souffle !), il conserve, en sus d’un appréciable volume, une maîtrise stylistique prometteuse de Liedersänger. Habituellement avare de pronostics, nous devinons en lui un digne Wotan pour les années futures. Exigeant des dons opposés, le rôle maléfique de la Nourrice se trouve avantageusement servi par la mezzo dramatique Lindsay Ammann. Détentrice d’un foyer grave de contralto, elle en use avec une délectable ostentation. Affublée d’un improbable maquillage (faisant songer à la Comtesse Geschwitz dans Lulu de Berg !), elle rejoint, en autorité vocale, les meilleures cantatrices entendues dans la Nourrice en scène (Mignon Dunn, Lívia Budai et Reinhild Runkel incluses). Médium et grave tranchants comme épée, quinte aiguë certes plus indurée voire métallique mais percutante : ces atouts se combinent à son timbre sans séduction qui convient idéalement au personnage, sans oublier ses inflexions vénéneuses, traduisant une intelligence exceptionnelle du texte.
Les rôles secondaires sont bien servis, même si l’on note un registre grave fluet chez Julian Orlishausen en Messager des Esprits. En revanche, aucune réserve pour le trio des frères de Barak ; Robert Lewis (aussi en charge de la voix du Jeune Homme), Pete Thanapat et Paweł Trojak (tous artistes du Lyon Opéra Studio) constituant une fine équipe qui fonctionne admirablement. Malgré la brièveté de leurs interventions, nous restons extatique devant les prestations supérieurement habitées de Giulia Scopelliti (le Faucon et Le Gardien du seuil du Temple) et Thandiswa Mpongwana (la Voix d’en-haut). Triomphe à tous pour cette liturgie sonore.
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN
25 Octobre 2023.