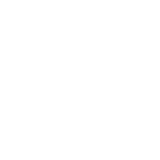Fait rare, permettez-nous d’ouvrir cet article par l’évocation d’une réminiscence personnelle : en 1977, alors lycéen, votre serviteur tombe sur un coffret de microsillons, où Tullio Serafin dirigeait les forces du San Carlo de Naples dans un opéra de Rossini inconnu de lui : Mosè. Il ne savait pas, alors, qu’il s’agissait de la 3ème mouture d’une œuvre dont, depuis plus de trente ans maintenant, il s’acharne à faire saisir la grandeur aux publics de ses conférences. Fasciné aussi par la couverture de cet album publié en 1957 sous label Fontana, il l’acquit et l’écouta jusqu’à l’usure. Si Nicola Rossi-Lemeni et Giuseppe Taddei s’y montraient déjà philologues et visionnaires, il ignorait encore combien Caterina Mancini, Bruna Rizzoli ou Mario Filippeschi restaient étrangers au style requis, malgré leurs indéniables bravoures respectives.
Pour ce qui concerne la 2ème mouture, jouée ce soir, rappelons que sa renaissance en France commença vraiment par un concert de l’ORTF en 1974, où John Matheson dirigea, entre autres, les respectables Joseph Rouleau, Robert Massard, Michèle Le Bris et Adrian De Peyer. Ensuite, ce fut le fulgurant retour en scène de 1983 au Palais Garnier, dans la colossale scénographie de Luca Ronconi, avec Samuel Ramey, Jean-Philippe Lafont, Cecilia Gasdia, Shirley Verrett et Chris Merritt. Puis, tandis que Mosè in Egitto bénéficiait de l’intégrale de Claudio Scimone au disque et revivait à Pesaro, la France négligea l’avatar français (une notable version de concert à l’Opéra de Marseille en 2014 mise à part), jusqu’à la production d’Aix-en-Provence de l’été 2022, aujourd’hui reprise à Lyon.
Où l’on constate rapidement un passage du bon au mauvais usage de la vidéo
Si l’Opéra de Lyon a, depuis 22 ans, proposé tous les autres opéras en français de Rossini, Moïse & Pharaon manquait à l’appel. Déjà au XIXème siècle, l’œuvre y apparut tardivement, au cours de la saison 1853/1854, puis s’éclipsa, jusqu’au présent retour. Christian Jarniat ayant déjà parfaitement décrit l’aspect visuel de cette production, nous n’y revenons pas.*
En revanche, pour ce qui relève de notre ressenti, évacuons le concept scénique de Tobias Kratzer qui, après Guillaume Tell en 2019, se divertit encore à actualiser (quelle originalité !) sans expliciter pour autant le propos originel, l’affadissant, l’affaiblissant dans une relecture superficielle, prosaïque, incongrue, factice, manichéenne, ne signifiant souvent rien, cumulant les poncifs du genre. Le pire résidant dans ces exaspérants dialogues muets mimés, cache-misères alliés à de vaines et quasi continuelles gesticulations outrées, relevant du plus mauvais cinéma d’avant 1927 (sur ce dernier point, le pompon se situe pendant l’ultime air d’Anaï, où le pauvre Aménophis en devient burlesque !).
Le début du dernier acte atteint les limites de l’aberration. Seul moment authentiquement grandiose : le soulèvement des flots juste avant le passage de la Mer Rouge, où l’espace d’un instant, l’on voit tout ce que les technologies actuelles permettraient de réaliser en servant l’action et le livret. Cela ne dure que trente secondes mais, pour cette vision sublime, merci au sieur Kratzer ! Ensuite, tout chavire (!), puisque l’on constate rapidement un passage du bon au mauvais usage de la vidéo, le public allant jusqu’à s’esclaffer en voyant les « égyptiens » (comment les nommer ?) en robes cocktail et costards-cravates s’ébrouant, avant noyade, dans les vagues de notre littoral. L’ultime image, avec ces benêts touristes bobos rôtissant leurs chairs sur une plage, étant carrément caricaturale, faisant tout tomber à plat, provoquant derechef l’hilarité dans la salle. Était-ce vraiment là l’intention ou le but recherché ?

À 58 ans tout juste sonnés, Michele Pertusi nous offre un Moïse mémorable
Comme dans 90% des cas actuellement, les sources auditives de satisfaction compensent les désillusions scénographiques, malgré un casting inégal. À 58 ans tout juste sonnés, Michele Pertusi nous offre un Moïse mémorable. Seul costumé à l’antique, il porte une tunique de lin similaire à celle de Charlton Heston dans le film Les Dix commandements. Ainsi, il n’a qu’à paraître pour incarner le personnage dans toute sa stature mythique, ce qui fait qu’on ne le quitte plus des yeux. Quelle que puisse être l’usure des moyens et leurs limites bien connues dans le registre grave – constatées dès ses débuts en 1984 –, le basso cantante émilien emporte tout sur son passage, déployant un sens inné du legato, du cantabile, une maîtrise de l’émission, une capacité superlative à smorzare, tout en chantant souvent sur le timbre, avec un confondant naturel. Soulignons enfin une ampleur sonore retrouvée, unie à une gestion belcantiste du souffle rayonnante, voire inouïe dans « Ô toi dont la clémence ».
Une fois chauffée, Ekaterina Bakanova, Anaï à l’émission d’abord inconfortable (dans le premier ensemble a cappella), succède dignement à Jeanine De Bique qui tenait le rôle à Aix. Progressivement, elle se révèle vaillante, dotée même d’un aplomb certain, avec des registres bien soudés : aigu assuré, médium consistant, grave sonore sans artifice. Lorsque l’écriture de l’Acte IV la met un peu en péril, elle négocie l’épreuve avec honneur. Autant à l’aise dans la passion que dans l’élégiaque, elle peut devenir un plausible soprano grand-lyrique d’agilité, à la condition d’user de prudence dans ses choix de rôles.
Non sans regrets, il s’avère malaisé d’être laudatif en ce qui concerne son soupirant éconduit. Prenant la relève de Pene Pati – Aménophis à Aix – le ténor Ruzil Gatin rappelle, par trop, feu Zurab Anjaparidze : même volume généreux mais technique sommaire. Est-ce un service à lui rendre que de le distribuer dans une tessiture aussi meurtrière ? Ingrat de timbre [autrefois, Rockwell Blake aussi, objecterez-vous ? Certes, mais quelle technique et quel style !], guère à l’aise avec la ductilité (la vocalisation reste laborieuse), Ruzil Gatin semble constamment crispé, anxieux, ce qui rend son chant mécanique dans l’éloquence, au point de virer à un effarant expressionisme au dernier acte. Cela nous peine de le relever car, lorsque l’organe n’est pas surexposé (section centrale du duo de l’Acte I avec Anaï), ce jeune artiste touchant révèle un beau sens du phrasé et des nuances, alliés à des efforts louables de diction.

Côté féminin, Vasilisa Berzhanskaya demeure l’époustouflante triomphatrice de la soirée
Substitué à Adrian Sâmpetrean en Pharaon, Alex Esposito se montre percutant, soigné de ligne, souple (vocalises intègres), énonçant un français perfectible mais plutôt châtié. En dépit d’un fâcheux relâchement expressionniste (décidément ! Nous ne sommes pourtant pas dans Cardillac d’Hindemith ?!?) dans le Finale de l’Acte III, le baryton-basse bergamasque possède l’ascendant, le terrible, la superbe, la noblesse autant que l’autorité du personnage.
Dans le rôle de son épouse, la Reine Sinaïde, Vasilisa Berzhanskaya renouvelle l’exploit relevé par Christian Jarniat à Aix. Côté féminin, elle demeure l’époustouflante triomphatrice de la soirée, offrant une prestation tout simplement irréprochable, avec sa projection péremptoire, sa franche largeur, son impressionnante capacité pulmonaire, son impact aussi bien dans le pianissimo que le fortissimo, ses inflexions variées, son adéquation stylistique (elle connaît, de toute évidence, tous les codes de ce répertoire et domine son sujet), sa maîtrise des ornementations (gruppettos et trilles d’exception !). En bref : elle a tout pour elle et peut devenir, un jour prochain, une personnalité de premier plan, car elle possède, de surcroît, une classe impériale, souveraine !
Nos respects, Madame.
Dans le rôle plus en retrait de Marie, Géraldine Chauvet constitue un luxe. Efficace et d’une fine musicalité, elle parvient à donner de la consistance à un emploi peu valorisant, s’adjoignant sans faillir à ses partenaires dans la Prière du IV, ce qui est tout à son honneur. En Eliezer, Mert Süngü s’avère idiomatique, possédant une belle présence et de l’étoffe, tandis qu’Alessandro Luciano campe un Aufide d’inhabituel relief. De ces deux ténors comprimari, la clef de fa d’Edwin Crossley-Mercer pourrait rejoindre les mérites si, au-delà d’un grave un peu court, il n’était perceptiblement desservi par une mise en scène qui rend falote son incarnation d’Osiride. Transformé en vil technocrate, ce pontifiant Grand-Prêtre d’Isis fanatique se dérobe, alors que sa fonction a autant d’importance théâtrale que celle, à peine moins épisodique, du Grand-Inquisiteur dans le Don Carlos de Verdi. Remarquons que cet artiste estimable tient aussi la brève mais cruciale partie de la voix mystérieuse à l’Acte I.

Achevons notre compte-rendu par le Maître d’œuvre de cette représentation : Daniele Rustioni, qui devient le légitime centre de gravité de cette production. Absolument déchaîné, le Directeur musical de l’Opéra de Lyon conduit toutefois l’ensemble des forces réunies avec majesté, très large, viscéralement « Grand-opéra Historique à la française ». Conjointement, son soin du détail autorise une mise en relief d’éléments d’orchestration imperceptibles sous d’autres baguettes, ce, dès le prélude initial. Jusque dans la mise en évidence des pizzicatos de cordes, de certains traits des bois – dont la tâche est ici ardue, ô combien ! – il nous conduit vers les plus sublimes hauteurs. Seul regret : qu’il n’ait point exigé de rouvrir les coupures des reprises, surtout celle de « Oh ciel ! Que mon martyre apaise ta rigueur ! », partie conclusive du capital duo opposant le Pharaon à son fils. Cette réserve exceptée, tout séduit. L’on peut compter sur une dramatisation exceptionnelle, couronnée par des cuivres vigoureux. Ajoutons cet art rarissime dans la construction des ensembles, dont il préserve ensuite l’architecture tout en les faisant respirer. Aucun doute : chef belcantiste émérite et verdien consacré, il retrouve ici ses marques. Bien mieux que dans Puccini où il s’égare, il domine la pulsation rossinienne. Cela se concrétise notamment dans une scène des ténèbres anthologique, exploitant un tempo pertinemment retenu, avec ces timbales et trompettes sourdes génératrices d’angoisse, jusqu’à un finale de l’Acte III à couper le souffle. Par ailleurs, quels merveilleux coloris il trouve dans le ballet, avec ces cordes étonnement rutilantes, sans oublier une mention pour les pupitres de harpes, hautbois clarinettes et cors, incroyablement saillants.
Dans son interprétation de ce Moïse & Pharaon, où Rossini transite progressivement vers le Romantisme tout en conservant des caractéristiques du plus pur Classicisme, une évidence se fait soudain jour. Daniele Rustioni nous doit les ouvrages majeurs de Gaspare Spontini (dont on célébrera en 2024 le 250aire de la naissance). À quand La Vestale ou Fernand Cortez sous sa prestigieuse direction ?
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN
26 janvier 2023

*lien de l’article de Christian Jarniat du 16 juillet 2022 :
http://www.resonances-lyriques.org/fr/chronique-detail/chroniques-operas/1123-moise-et-pharaon-au-festival-lyrique-aix-en-provence.cfm