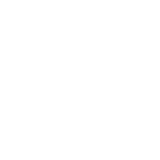La 6ème semaine de 2024 aura marqué la disparition de plusieurs personnalités éminentes au rayonnement international : le politologue Alfred Grosser, l’avocat Robert Badinter et le chef d’orchestre Seiji Ozawa. Réflexions sur des figures pour lesquelles la musique était une passion vitale. Elles appartenaient à un monde désormais en voie d’extinction, celui des grands humanistes.
*****
Le deuil n’est pas un, mais pluriel. Celui, d’abord, d’Alfred Grosser. Disparu à l’âge de 99 ans, l’éminent spécialiste des études germaniques avait vu le jour à Francfort le 1er février 1925. Après avoir été chassé d’Allemagne avec ses parents et sa sœur par le fanatisme nazi, il avait connu la clandestinité, retrouvé sa liberté de mouvements, étudié à la Sorbonne. Alfred Grosser devint ensuite l’un des artisans intellectuels majeurs de la réconciliation franco-allemande et l’un des professeurs les plus réputés de l’Institut d’études politiques (Sciences Po) de Paris. Comme il était issu d’une bourgeoise juive allemande éclairée, il en avait amené avec lui un goût affirmé pour la musique, escorté de connaissances techniques en la matière d’une telle ampleur qu’elles dépassaient de fort loin celles de la majorité des mélomanes. Alfred Grosser écoutait beaucoup de disques dans son appartement du 15ème Arrondissement. Il allait souvent au concert et à l’opéra. Il était devenu – avec Jean Kahn (1929-2013) – le co-président d’honneur du Forum Voix étouffées (FVE), œuvrant parmi l’Union européenne pour la réhabilitation des compositeurs victimes de l’hitlérisme.
J’ai eu l’honneur de connaître Alfred Grosser, autant que de le fréquenter durant la dernière décennie de sa riche existence. Ce polymathe avait une conception très traditionnelle des mises en scène d’opéra. Il l’avait inculquée à son épouse et à leurs fils. Je me souviens de discussions un peu vives sur le sujet. Elles se terminaient toujours sur un silence et sur des éclats de rire. Grosser avait beaucoup d’humour. De toute manière et comme il était un mandarin – pour nous autres spécialistes du monde germanique –, le regretté penseur finissait par l’emporter. Il pouvait alors clamer son déplaisir devant le Regietheater, formuler des remarques cinglantes au sujet de Bayreuth, de Salzbourg ou de la Scala aujourd’hui. Robert Badinter (1928-2024) était de la même génération que Grosser. Une génération connaissant ses classiques, entraînée à des joutes verbales de haut niveau. Une génération qui nous a formés, une génération nous ayant infiniment apporté. Si l’ancien garde des Sceaux était connu comme un ardent amateur d’art lyrique, au même titre que Lionel Jospin, il aura aussi laissé un livret d’opéra. Badinter écrivit le livret d’un ouvrage de Thierry Escaïch (*1965) intitulé Claude et crée à l’Opéra de Lyon en 2013. Olivier Py (*1965) signa la mise en scène de ce récit tiré d’une nouvelle de Victor Hugo et se déroulant à la prison de Clairvaux. Un lieu relevant de l’évidence professionnelle pour Badinter.
Voilà qui mène – par association d’idées – au Fidelio de Beethoven. Il fut conduit en 1982, à l’Opéra de Paris, par un Seiji Ozawa (1935-2024) plus sautillant que jamais. Il y dirigea aussi, la même année, Tosca de Puccini. J’assistai à des répétitions de ces ouvrages. Le maestro nippon était adoré par l’orchestre. Ses membres connaissaient sa passion de la musique française, ses exploits au concours international de direction de Besançon en 1959 – il y serait arrivé à moto – ses liens forts avec les partitions de Berlioz et de Dutilleux. L’Alsacien Charles Munch (1891-1968), président du jury bisontin, prépara le chemin de l’Orchestre symphonique de Boston (OSB), dont il était le maître, à Ozawa. Le Nippon y régna de 1973 à 2002, poursuivant une tradition timbrique instituée là par Munch. N’avait-il pas emmené outre Atlantique des instrumentistes à vent français ? Au Massachusetts, personne ne contesta l’autorité, l’ascendant doux et malicieux d’Ozawa. La vielle dame susceptible nommée Orchestre philharmonique de Berlin (OPB) fondit aussi devant lui. Je me rendis en 1982 à Berlin, afin d’y assister aux solennités de la célébration du 100ème anniversaire de l’Orchestre philharmonique. Je me souviens d’un concert consistant en une succession de numéros présentés par de grands virtuoses. Je me rappelle d’une salle mise en folie par Ozawa. Il partageait cette caractéristique rarissime avec Carlos Kleiber et avec Leonard Bernstein. Sa petite taille contrastait avec la grandeur de la musique dont il exprimait autant les arches que les subtilités.
La fin novembre 1983 vit – au Palais Garnier – Ozawa au pupitre de la création mondiale de Saint François d’Assise d’Olivier Messiaen (1908-1992). Admirateur du Japon et de l’art d’Ozawa, le compositeur lui avait confié la lourde charge d’une œuvre d’une durée de quatre heures. Ses protagonistes – dont José van Dam (*1940) et Christiane Eda-Pierre (1932-2020) – se trouvaient en compagnie d’un orchestre gigantesque et de chœurs pléthoriques. Ozawa avait fait fabriquer chez un sellier réputé un bagage destiné à transporter la partition de Saint François. Le déroulement des scènes franciscaines eut un retentissement planétaire, quand bien même il n’ajouta rien à la gloire de Messiaen. Je suivis la répétition générale et trois des huit représentations de ce poème mystique. Installée devant ses ondes Martenot dans une loge d’avant-scène, Jeanne Loriod (1928-2001) – la belle-sœur du compositeur – portait un somptueux sari brodé d’or. Pour sa part, Ozawa réglait en permanence les problèmes d’équilibre interne d’une œuvre aussi redoutable que les Gurrelieder d’Arnold Schönberg. La reconnaissance de Messiaen fut immense. Elle suscita, par la suite, l’entrée d’Ozawa dans l’Ordre national de la Légion d’honneur et son admission à l’Académie des Beaux-Arts. Il y fut reçu avec la pompe habituelle.
Parmi les derniers concerts conduits par Ozawa, son retour triomphal à Berlin en avril 2016 demeure un souvenir impérissable. Nous le gratifiâmes d’une standing ovation d’une durée de huit minutes avant qu’il commence à diriger. Devenu un grand malade, il était alors en rémission. Son endurance était désormais limitée. La première partie des soirées fut vouée à la Gran Partita K. 361 de Mozart, donnée par les vents et un contrebassiste de l’OPB. Nous fûmes ensuite régalés de l’ouverture d’Egmont opus 84 et de la Fantaisie pour piano, chœurs et orchestre opus 80 de Beethoven. Au clavier se tenait le regretté Peter Serkin (1947-2020). Ensuite, Ozawa fut fait membre d’honneur de la phalange, comme cela s’était déjà produit avec l’Orchestre philharmonique de Vienne. Les ultimes Beethoven que j’entendis alors d’Ozawa soulignèrent à quel degré il était un interprète instinctif, animal, à l’inverse de la plupart des musiciens japonais trop sages, trop respectueux, trop avalés par les chefs-d’œuvre qu’ils servent.
Ces lignes de tristesse doivent se conclurent sur la destruction d’une information erronée. Seiji Ozawa ne fut pas le premier musicien classique japonais apprécié en Occident. Peu après le début – en 1868 – de l’Ère Meiji, les élites musicales japonaises se virent formées à Berlin, à Leipzig et – dans une moindre mesure – à Vienne. Des spécialistes nippons assistèrent en 1876 au premier Festival de Bayreuth. En 1924, Hidemaro Konoye (1898-1973) dirigea l’Orchestre philharmonique de Berlin. Mais il ne suscita pas l’éblouissante stupeur amenée en 1966 par Ozawa lors de ses débuts à la tête de la glorieuse phalange. Il y fut qualifié de « Paganini de la baguette » en donnant du Schumann, du Hindemith et du Beethoven.
Dr. Philippe Olivier