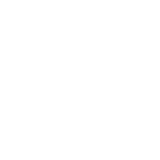Voici un texte que j’ai longtemps cherché sans arriver à le trouver. Le parisien Edouard Drumont (1844-1917), wagnérien de la première heure, à l’instar des Léon Leroy, Judith Gautier, Catulle Mendès, Edouard Schuré et Villiers de l’Isle-Adam, avait 25 ans lorsqu’il l’écrivit et le publia sous la forme d’une brochure aujourd’hui difficilement trouvable. Elle se vendit en 1869 au prix de 50 centimes1.
Nous trouvons ici une prose intelligente et élégante. Le texte rend hommage au génie de Wagner, dont il cerne la personnalité avec une sagacité attachante. Le sous-titre, À propos de Rienzi, est trompeur. Ce texte a été publié à l’occasion de la première parisienne de Rienzi, sans évoquer cet opéra.
RICHARD WAGNER. L’HOMME ET LE MUSICIEN
I
Dans quelques jours on représentera au Théâtre-Lyrique Rienzi ou le dernier des Tribuns romains, et le nom de Wagner va de nouveau être jeté en pâture aux discussions ardentes, il va soulever les fanatismes et les négations, déchaîner les applaudissements et les railleries. Il nous a paru intéressant d’indiquer la physionomie de l’homme et la personnalité de son génie.
Il nous a semblé curieux de revenir en arrière et d’étudier le bruyant passage de Wagner à Paris, de visiter ce champ de bataille artistique où le novateur fut écrasé et non vaincu, et de revoir en appel les pièces de ce procès où Wagner fut condamné sans être entendu, ce qui est mortel pour un musicien qui ne triomphe qu’en étant écouté.
Ce n’est point que nous prétendions évoquer des souvenirs qui , parce qu’ils sont oubliés, ont l’attrait de la nouveauté. Jamais l’auteur du Tannhauser et le système wagnérien ne furent plus présents à Paris que du jour où Wagner fut parti, attristé et plein de dédains, que du jour où la formule nouvelle parut écroulée avec le Tannhauser.
Pour les grands artistes comme pour les grands politiques, pour les doctrines comme pour les individus, la défaite présente est presque toujours le germe du triomphe futur. Dans la Politique et dans l’Art , les lois sont identiques. Tout est action et réaction.
L’idée napoléonienne triomphait partout, chère à tous et presque indiscutée après Waterloo, alors que son créateur mourait au delà des mers, et l’on comptait plus de bonapartistes quand un Bourbon régnait qu’on n’en compte assurément aujourd’hui que règne un Bonaparte.
Quelque chose d’analogue s’est passé pour Wagner. Débarrassée des faiblesses de l’homme l’Idée a fait son chemin, et dans notre Panthéon de chefs-d’œuvre, aux portes trop étroites pour recevoir une œuvre tout entière, l’œuvre wagnérienne est entrée par fragments. L’Ouverture, la Marche, le Chœur des pèlerins, sont acceptés maintenant et admis, même de la foule, comme d’impérissables merveilles.
En entreprenant cette étude nous n’avons donc pas, encore une fois, l’intention de découvrir un homme de génie ou de plaider une thèse contestée. Les gens de bonne foi admettent Wagner comme on admettait, même avant 1830, Hugo et Delacroix. Nous voulons tout simplement esquisser , à l’aide de notes exactes , l’existence du réformateur de la musique2.
II
Wagner est né à Leipzig, en 1813, au milieu du grand bruit que faisaient les dernières guerres de l’Empire , secouant l’Allemagne jusque dans ses fondements. Peut-être dût-il à sa naissance au sein des orages le souffle révolutionnaire et violent qui traverse son œuvre.
Plus heureux que les pauvres petits prisonniers qui s’étiolent dans les collèges et les lycées de France, Wagner reçut une éducation complète dans ces universités et ces gymnases allemands qui semblent une réminiscence de ces merveilleuses écoles d’Athènes, où l’on apprenait à la jeunesse à connaître et à comprendre le Beau sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, où, loin de classer et de parquer l’homme en formation dans une spécialité étroite , on lui donnait pour horizon les espaces immenses de l’intelligence humaine.
Passionné pour la métaphysique et la philosophie, Wagner promettait d’être un redoutable successeur d’Hegel, quand une symphonie de Beethoven lui révéla sa vocation pour la musique et le décida à prendre pour interprète du Vrai et du Beau, au lieu du livre qui ne s’adresse qu’à l’élite, la forme musicale qui s’adresse à tous. Une grande symphonie qu’il fit prier à la Gewandhaus en 1832, fut son début.
Chef d’orchestre à Magdebourg et à Riga , Wagner se maria dans cette dernière ville à une actrice du théâtre, et fit représenter, à Dresde, les Fées et le Novice de Palerme, qui n’eurent aucun succès.
Triste, découragé, encore en quête de sa voie, creusant son génie comme on creuse un sol aurifère pour y découvrir le vrai gisement, Wagner vint à Paris chercher la fortune et la gloire. Il y connut toutes les douleurs et toutes les âpretés du début, et, pour vivre, l’immortel auteur du Tannhauser fut réduit à arranger la Favorite pour deux flûtes sur la commande d’un éditeur compatissant.
Le futur favori des rois vivait en ce temps-là avec dix-neuf sous par jour et habitait une mansarde rue de la Tonnellerie, dans la maison même où était né Molière !
Candide comme un homme de génie et naïf comme un Allemand, le pauvre Wagner, en débarquant à Paris, s’imaginait qu’il n’aurait qu’à apporter un chef-d’œuvre à l’Opéra pour le faire jouer aussitôt.
Donc, un beau matin, il s’en vint trouver Léon Pillet, qui dirigeait alors les destinés de l’Académie de musique ; il avait sous son bras le Vaisseau fantôme.
» Monsieur, je suis inconnu , mais je vous apporte un ouvrage que je serais heureux de voir représenter chez vous. »
Léon Pillet fut stupéfait de cette candeur. Le ciel s’écroulant sur sa tête l’eût moins étonné que le tranquille aplomb de l’honnête enfant de la Germanie. Vainement il essaya de faire comprendre au jeune homme quelle chose inouïe, immense, impossible c’était pour un débutant que de forcer l’entrée du Grand- Opéra.
» Enfin , monsieur, vous êtes ici pour prendre connaissance des œuvres qu’on vous soumet ; je vous laisse mon manuscrit, » reprit paisiblement Wagner avec une obstination tudesque.
Léon Pillet était tellement étonné qu’il se laissa mettre le manuscrit dans les mains. Quinze jours après, imperturbable dans sa naïveté, Wagner revenait demander une réponse . Chose inouïe ! il fut reçu! Au lieu de le mettre au rancart, Léon Pillet avait, dans une heure d’ennui, jeté les yeux sur le Vaisseau fantôme.
» Jeune homme , il y a une idée dans votre affaire. Je l’accepte. «
Le cœur du pauvre débutant bondit sans doute dans sa poitrine ; il se dit que tous ces gens, qui parlaient d’obstacles et de difficultés, étaient ou des imbéciles ou des jaloux. Inconnu , étranger , sans protections, il allait avoir une pièce jouée sur le premier théâtre du monde….
» Eh bien , monsieur , quand pourrai -je vous faire entendre ma musique au piano ? «
» Votre musique ? Ah ! nous n’en avons pas besoin ! … et Pillet eut un geste ineffable de mansuétude et de dédain. Nous vous laissons la musique, mais nous prenons le livret et nous le payons 500 francs. » C’était un rude coup pour ce pauvre homme de génie, aux yeux duquel venait de luire , pendant une seconde , une si magnifique espérance.
On pense sans doute qu’il se leva indigné et qu’il foudroya de la conscience de son génie le directeur de l’Opéra. Ceux qui pensent ainsi n’ont jamais subi les angoisses de la pauvreté. Wagner demanda huit jours pour réfléchir et, deux jours après, la misère, le prenant par la main , le ramenait chez Léon Pillet . Avec ces 500 francs, Wagner s’enfuit à la campagne, à Meudon, et dans l’ombre des bois, et sous la fraîcheur des arbres, il écrivit le Tannhauser, qui devait, quelques années plus tard, être représenté à l’Opéra et servir de champ de bataille à la lutte de deux écoles.
Léon Pillet donna le Vaisseau fantôme à Distch, le chef d’orchestre qui le tourmentait depuis longtemps pour avoir un livret. Distch fit là-dessus une musique inepte, qui fut sifflée et gagna l’immortalité à cette circonstance, car les savants qui, dans quelques siècles, feront des commentaires sur le Vaisseau fantôme de l’homme de génie, diront certainement un mot en passant du Vaisseau fantôme de l’homme médiocre.
Le pauvre Allemand n’avait qu’un désir, celui de quitter cette terre inhospitalière. Meyerbeer lui en facilita les moyens et lui fit obtenir la place de maître de chapelle auprès du roi de Saxe, position qu’avait jadis occupée Weber. Un bienfait est toujours perdu, dit le sage. Wagner, dont le caractère n’est pas à la hauteur du génie, témoigna plus tard sa reconnaissance à Meyerbeer en l’éreintant dans l’ouvrage intitulé : De l’Opéra et du Drame (2).
III
Wagner fut vite en faveur auprès de la cour de Saxe, cour artiste et amie des plaisirs intellectuels comme une petite cour italienne au temps de la Renaissance. Il fit représenter au théâtre de Dresde Rienzi, qui obtint un immense succès. C’est ce Rienzi que nous allons entendre , et disons le en passant, il ne donne que d’assez loin l’idée du système qui devait aller jusqu’à Tristan et Iseult. Il appartient à la première manière du maître qui, dans cet opéra de transition, semble flotter entre Gluck, Meyerbeer et Weber. Il y a dans Rienzi autant de mélodies que dans n’importe quelle partition de Verdi. — Ceux qui applaudiraient et ceux qui siffleraient au nom d’un système seraient également dans l’erreur.
Après Rienzi vint le Tannhauser, qui fut accueilli avec enthousiasme, et enfin Lohengrin.
Les événements de 1848 arrivèrent. Wagner, républicain comme tous les gens intelligents, ingrat et cruel comme tous les fanfarons de démocratie, demanda la tête du souverain qui l’avait comblé de bienfaits. Le souverain tint à garder sa tête, le mouvement fut comprimé et Wagner fut obligé de se réfugier en France. Belloni, secrétaire de Liszt, lui trouva un asile à Reuilles. Il resta là quelques mois , pleurant presque toute la journée et se plaignant amèrement de ne pas avoir sa femme avec lui. Il alla plus tard rejoindre sa femme à Zurich, se fixa en Suisse et ne quitta désormais ce pays que pour aller donner à Paris ses fameux concerts .
IV
Du fond de sa retraite de Zurich, Wagner avait malgré tout les yeux constamment tournés vers cette France, où jusque-là cependant il n’avait trouvé que le dédain et la misère. Il rêvait, pour son œuvre, la consécration de Paris. Un éditeur dévoué donna à Wagner les moyens d’entamer cette campagne décisive. M. Schott acheta dix mille francs, sans savoir s’il serait jamais représenté, le gigantesque opéra des Niebelungen, qui contient quatre opéras en un seul le Rheingold (l’Or du Rhin), dont un acte se passe au fond du fleuve et dont Wagner avait fait lui-même la machination avec cette multiplicité de facultés que possédaient les grands artistes du seizième siècle, la Walküre, la Jeunesse de Siegfried et la Mort de Siegfried.
En arrivant à Paris, Wagner rencontra Giacomelli. Connu de tout le monde artistique et complètement ignoré de la foule, Giacomelli est une personnalité. Le bureau de rédaction de la Presse musicale est le rendez-vous de tous les ténors, barytons, basses, soprani, contralti, de tous les pianistes, violonistes, violoncellistes du monde. Il organise, à lui seul, en trois mois, plus de concerts qu’un mélomane n’en pourrait entendre en dix ans. Habile, souple, jouant du monde parisien avec la délicatesse et la sûreté qu’un exécutant consommé déploie à toucher le clavier d’un piano, enthousiaste du beau comme un artiste et adroit comme le plus retors des hommes d’affaires, Giacomelli fut pour Wagner d’un inappréciable secours. Tout autre que Wagner, disons le, eût triomphé avec le fanatique concours de Giacomelli.
Il s’agissait d’abord de faire connaître Wagner à Paris.
On s’occupa d’organiser des concerts. Ce furent d’inextricables et sans cesse renaissantes difficultés. Avant tout, il fallut trouver une salle, et la salle des Italiens réunissait seule toutes les conditions nécessaires.
Calzado, qui n’attachait pas ses chiens avec des saucisses, s’il mettait des paquets de cartes préparées dans ses poches de côté, éleva devant Wagner d’exorbitantes prétentions. La salle fut louée huit mille francs, et Wagner devait payer, à part l’orchestre l’éclairage et les frais accessoires. Ce fut bien une autre affaire pour organiser l’orchestre formidable indispensable à l’exécution .
Il arriva cette fois encore ce qui se produisit au Conservatoire quand Habeneck fit répéter les premières symphonies de Beethoven. Les musiciens, — tous gens de valeur et de talent cependant, — furent complètement désorientés et déclarèrent la musique de Wagner impossible à la première répétition. À la fin de la troisième, une immense acclamation s’éleva, et, pendant cinq minutes, l’orchestre couvrit d’applaudissements et de hurrahs le puissant maestro ému et enorgueilli comme un général salué imperator par ses soldats. Voici quel était le programme du premier concert :
La sensation fut profonde à Paris, et malgré d’énergiques protestations, les concerts eurent un grand succès. La critique se partagea en deux camps. Franck Marie, Gasperini, Rayer, Saint-Valry, Léon Leroy, pour ne citer que ceux-là, se déclarèrent pour Wagner. Azevedo, Fétis , Chadeuil le traitèrent de sauvage et de fou. Chez Scudo, l’hostilité prit les proportions de la rage. M. Perrin écrivit dans la Revue contemporaine quelques articles très remarquables et très enthousiastes. M. Jouvin, — un converti d’hier, — déclara que si Berlioz était le Robespierre de la musique, Wagner en était le Marat. Berlioz fit , dans les Débats, un feuilleton fort embarrassé , qui lui attira une lettre très vive de Wagner, lettre qui fut insérée dans le même journal. Rossini se déclara admirateur de Wagner et écrivit pour protester contre un mot ridicule qu’on attribuait au Cygne de Pesaro. Champfleury publia une biographie de Wagner qui fit grand bruit.
M. Albert Wolff, qui poursuit depuis quelque temps son compatriote de railleries d’un goût assez douteux, fut dithyrambique dans son compte rendu. En voici quelques lignes :
Reçu à son entrée dans la salle par des applaudissements frénétiques, Wagner eut quelque peine à cacher son émotion …. Enfin la bataille commença.
Tannhauser et le Vaisseau fantôme ont donné les premiers et emporté le succès à la baïonnette. Après quelques escarmouches brillantes, Wagner donna l’ordre à sa vieille garde de marcher. Alors l’orchestre et les chœurs ont entonné la finale de Lohengrin une des pages les plus brillantes, les plus audacieuses de la musique moderne.
Le public, les musiciens, les choristes électrisés se levèrent comme un seul homme et témoignèrent par leurs bravos enthousiastes désormais le que talent de Wagner était naturalisé français.
Voilà en quels termes, en 1860, M. Albert Wolff parlait de celui qu’il appelle maintenant le Polonais de la Musique. Il ne nous appartient pas d’estimer les raisons qui ont pu le faire changer d’avis. À la suite des concerts de Paris, Richard Wagner fut demandé à Bruxelles et y donna deux grands concerts au théâtre de la Monnaie. Ce fut la répétition des concerts de Paris, même désordre et même tâtonnement chez les musiciens de l’orchestre, même enthousiasme quand la lumière jaillissant tout à coup dans cette nuit profonde illumina l’œuvre du Génie, même sensation et même succès.
Fétis ne goûta que médiocrement le système de Wagner. En vain Wagner était venu lui exposer ses idées avec cette verve, cette éloquence, cette hauteur de vue qu’il apporte dans sa conversation. Fétis écouta sans dire un mot, la tête dans ses mains , et son premier soin fut de demander la révocation de M. Samuel, professeur au Conservatoire, qui s’était fait le courageux champion de la formule nouvelle. M. Samuel ne perdit rien du reste à cette disgrâce, il organisa les Concerts populaires de Bruxelles, et devint quelque chose comme le Pasdeloup de là-bas .
V
Pour Wagner, les concerts n’étaient qu’un moyen de se faire connaître et d’arriver à l’Opéra. On fit quelques démarches rue Lepelletier, mais M. Alphonse Royer était au moins aussi timide que M. Léon Pillet. On n’obtenait que des réponses évasives. Wagner comptait déjà cependant des partisans influents et dévoués. Mme de Metternich, sympathique aux arts comme une grande dame d’autrefois, s’était déclarée chaleureusement pour lui. Les frères Erlanger lui avaient ouvert un crédit. Le comte de Hasfeld était un de ses grands admirateurs. Cependant les choses n’avançaient pas.
En vain on multipliait les visites chez le comte Bacciochi, on n’était pas reçu ou on l’était mal. Les domestiques mêmes dans leur sphère modeste semblaient ennemis de la musique de l’avenir. Détail assez ignoré. C’est au maréchal Magnan et non à Mme de Metternich que revient l’honneur d’avoir fait jouer le Tannhauser . Wagner avait remarqué son assiduité et son attention aux concerts. Sur le conseil de Giacomelli il lui demanda une audience. Deux heures après une estafette arrivait à franc étrier porter une lettre du maréchal annonçant qu’il attendait Wagner pour le lendemain.
Wagner reçut du maréchal un accueil on ne peut plus sympathique. « Monsieur, lui dit Magnan en le quittant, je suis un soldat et non un dilettante, mais votre musique m’a passionné et ému, j’aurai l’honneur de voir l’Empereur ce soir et je vous donne ma parole de lui parler de vous. »
La parole fut tenue, et quand, quelques jours après, Wagner revint au ministère, les domestiques, les employés, le comte Bacciochi, tout le monde était devenu wagnérien.
M. Royer reçut l’ordre de jouer le Tannhauser. Quand il fallut lui faire entendre la partition, ce fut le baron de Bulow, gendre de Litz, qui la joua tout entière de mémoire.
Les rôles furent ainsi distribués : « Vénus, Mme Tedesco. Élisabeth, Mme Sass, Wolfram, Morelli. Le pâtre, Mlle Mélanie Reboux. On fit venir d’Allemagne le ténor Niemann que Wagner avait perdu de vue depuis longtemps, mais qui s’était acquis une immense réputation en jouant les opéras du maître. Ce dernier choix fut malheureux de toutes les façons, et quand les querelles éclatèrent à l’Opéra, Niemann se déclara ouvertement contre Wagner.
Les répétitions commencèrent. Le caractère absolu de Wagner, qui contrastait avec la douceur mielleuse de Meyerbeer, lequel obtenait tout par l’aménité de son langage, jeta le trouble à l’Opéra. Bientôt le maître eut contre lui tous le chefs du service et même le chef de claque, l’illustre M. David. Pour comble de maladresse, Wagner publia en ce moment ses poèmes d’opéra avec une préface fort orgueilleuse et fort mal traduite qui fut plus mal interprétée encore et qui indisposa l’opinion publique contre lui.
Cependant tout Paris était en rumeur. On sortait à peine de cet effroyable silence qui suivit le coup d’État, et pendant lequel on n’entendait que le murmure des serviles adulations et le bruit des sacs d’écus qu’on vidait dans la caisse sans fond des grandes compagnies. Un événement artistique était aussi important alors qu’un défi entre les blancs et les bleus dans l’antique Byzance. Toute la passion détournée des luttes politiques se reportait de ce côté.
Deux partis se formèrent acharnés, aveugles, absolus, qui prirent pour signe de ralliement la plume du chapeau de deux grandes dames. Mme de Metternich était wagnérienne, Mme Walewska se déclara contre Wagner. Comme au temps de la Fronde deux femmes furent les chefs d’une armée. Les abonnés de l’Opéra étaient hostiles à Wagner, car Wagner avait tout d’abord absolument refusé de se prêter aux ridicules conventions de l’Opéra français et d’intercaler un ballet dans le Tannhauser. Il avait fini cependant par se décider à composer la Bacchanale, une des perles éclatantes de cette merveilleuse partition, mais cette concession tardive et incomplète ne satisfit personne.
La première représentation approchait. Le mot d’ordre fut donné : il ne fallait pas laisser entendre la pièce et surtout ne pas la laisser finir. On enrégimenta des domestiques qui occupèrent les places inférieures. On acheta partout des sifflets de chasse et l’on fit une razzia de ces petits chiens de treize sous qui aboient quand on les presse un peu. Les places atteignirent des prix inouïs pour une époque où la manie des premières n’était pas devenue comme en ces derniers temps une espèce de délire. Tout le monde s’attendait à une soirée à émotion.
Jusqu’au dernier moment Wagner avait demandé à conduire l’orchestre lui -même ; dans cette bataille mémorable il voulait exposer sa personne en même temps que son œuvre. Distch , — celui qui battait la mesure en rond, — refusa obstinément de lui laisser prendre le bâton du commandement .
VI
La toile se leva enfin sur le Tannhauser.
On écouta d’abord en silence . La Bacchanale donna lieu à quelques protestations. Le duo entre Vénus et le Tannhauser, auquel Wagner avait eu le tort de donner d’excessives proportions, fut légèrement sifflé. Mais ce fut au concours des chantres d’amour que l’orage éclata. Aux sifflets, aux cris : assez ! assez ! répondaient de frénétiques applaudissements. C’était un tumulte indescriptible. Les chanteurs restaient sur la scène sans pouvoir parvenir à se faire entendre. Ni à cette première ni aux réprésentations suivantes on n’entendit un mot du célèbre pèlerinage dit par Nieman.
Telle fut la première du Tannhauser.
Caché au fond de la loge de la direction, Wagner assistait impassible à ce désastre, écoutant plus sans doute cette magnifique musique qui lui affirmait son génie que les sifflets qui ne prouvaient que la grossière brutalité du public de l’Opéra. La première soirée avait été une soirée agitée, la seconde faillit être une bataille. Malgré la présence de l’Empereur on siffla avec une recrudescence de violence. Les gens du monde une fois sortis de leur calme conventionnel et de leurs convenances factices montrent plus de brutalité et de violence que le goujat vulgaire. On sifflait, je l’ai dit, malgré la présence du Souverain, ce qui est peut-être permis aux républicains, mais qui est de la plus suprême inconvenance pour des gens qui acceptent l’étiquette et qui s’y conforment servilement en temps ordinaire. On insultait la princesse de Metternich, intrépide et superbe dans son enthousiasme, et chaque fois qu’elle applaudissait, une partie de l’orchestre se retournait vers elle en sifflant comme pour la narguer et lui dire: » Vois ce que nous faisons de l’œuvre de cet homme de génie que tu aimes et que tu défends. »
De vrais gentilshommes, des grands seigneurs d’autrefois eussent respecté leur Souverain, une femme, un étranger. L’aristocratie de la démocratie n’a point le sens de toutes ces choses, elle reste peuple malgré l’apparence, elle redevient populace quand elle est excitée et déchaînée, et sous le gant blanc vous trouverez encore la main brutale, marque indélébile de l’origine prolétaire.
Ce sera certes ure vilaine page dans l’histoire artistique de la France que l’accueil fait au Tannhauser. Ce fut pour les honnêtes gens et pour les gens de cœur un triste spectacle que de voir tous ces impuissants qui avaient trouvé une fortune dans leur berceau se faire un jouet de l’arme meurtrière du sifflet et goûter une joie stupide à écraser un chef- d’œuvre, à briser le cœur d’un homme de génie.
À la troisième représentation , qui eut lieu huit jours après la seconde, la courageuse princesse de Metternich, lasse de lutter contre cette aveugle fureur des gandins, vit que tout était perdu. On peut toucher le cœur d’un jacobin farouche, quelque chose bat encore sous cette rude poitrine. Quel moyen employer contre ces âmes de petits crevés, — on ne les appelait pas encore ainsi, — âmes vides, desséchées, ankylosées, pétrifiées ? Devant cette imbécillité implacable, la pauvre princesse brisa son éventail comme un soldat, accablé par le nombre, brise son épée, et vint, suffoquée de larmes, tomber au fond de sa loge.
Le commissaire de police s’était obstinément refusé à rétablir l’ordre. Sa consigne était : Laissez passer la justice du Jockey-club. « Ces messieurs sont du Jockey, » disait-il, quand on lui montrait quelqu’un troublant évidemment le spectacle et qu’il n’eût pas hésité dans un autre lieu à faire brutaliser par ses agents et à mettre au violon pour lui apprendre à respecter la musique. Ils sont du Jockey, et il en avait plein la bouche, de ce mot du Jockey. Murat, Aguado, etc., étaient au nombre des siffleurs, conséquemment on avait le droit d’empêcher le vrai public d’entendre et de juger.
La direction avait malgré tout des velléités de résistance, ce qui s’explique peut-être par ce fait que la salle était entièrement louée jusqu’à la seizième représentation. Mais, à la suite de la troisième représentation, une conférence eut lieu chez Wagner. Le baron Erlanger, Nuitter, Gasperini, Giacomelli assistaient à cette conférence. Il fut décidé qu’on retirerait la pièce et on rédigea, en commun, la lettre suivante pour M. Alphonse Royer :
Monsieur le Directeur,
L’opposition qui s’est manifestée contre le Tannhauser me prouve combien vous aviez raison quand, au début de cette affaire, vous me faisiez des observations sur l’absence du ballet et d’autres conventions scéniques auxquelles les abonnés de l’Opéra sont habitués.
Je regrette que la nature de mon ouvrage m’ait empêché de me conformer à ces exigences. Maintenant que la vivacité de l’opposition qui lui est faite ne permet même pas à ceux des spectateurs qui voudraient l’entendre d’y donner l’attention nécessaire pour l’apprécier, je n’ai d’autre ressource honorable que de le retirer.
Je vous prie de faire connaître cette décision à S. Exc . M. le Ministre d’État .
RICHARD WAGNER
VII
Les journaux, après le Tannhauser comme après les concerts, se partagèrent à peu près également en deux camps. Tous, cependant , ou presque tous, furent d’accord pour constater que l’on avait empêché le vrai public d’entendre et de se prononcer en connaissance de cause, sans flétrir néanmoins les braves gens qui avaient commis cette action honteuse vis-à -vis d’un étranger. C’était surtout avec la loi de ce temps – là que toute vérité n’était pas bonne à dire. Janin écrivit sur l’éventail brisé de la princesse de Metternich un feuilleton splendide d’un bout à l’autre. Il est brisé le bel éventail …
Dans les choses les plus tristes, a-t -on dit, il y a toujours un côté gai. Le côté gai fut l’indécision des officieux. La princesse Walewska était la femme du ministre d’État, mais Mme de Metternich avait une grande autorité à la cour. Un ministre d’État est un personnage, mais l’ambassadeur d’une grande puissance avec laquelle on est d’autant mieux qu’on vient de se battre avec elle, n’est pas une force à dédaigner, et ils étaient comme un huissier qui entend tinter deux sonnettes à la fois. Enfin, on vit, un jour, Fiorentino sortir radieux du ministère. « Enfin, s’écria-t-il, je vais pouvoir l’aplatir… »
Wagner resta à Paris un an encore environ après le Tannhauser. Avec ses goûts dispendieux, son amour des belles choses, il s’était fait une légion de créanciers. La générosité d’un éditeur l’aida encore à sortir de ce mauvais pas. Flaxand avait acheté et payé la partition du Tannhauser bien avant la représentation. Après le désastre, il vint trouver Wagner et lui offrit spontanément une somme considérable, en s’excusant de ne pouvoir faire davantage
Le décret de proscription venait d’être révoqué. Wagner retourna à Zurich, d’où le jeune roi Louis II, de Bavière, le fit venir à Munich. La façon dont il fut amené près du roi a je ne sais quoi du despotisme fantaisiste des cours d’Orient . « Je veux voir Wagner, » dit le roi Louis un matin en s’éveillant ; et un aide de camp reçut l’ordre de trouver et d’amener Wagner au monarque.
On disait le maître à Vienne.
Pendant trois jours et trois nuits l’aide de camp parcourut Vienne dans tous les sens, fouilla la ville dans tous les coins et recoins,, alla des bouges aux palais et des palais aux bouges. Pas de Wagner ! Quand il revint sans Wagner, le roi fronça son royal sourcil. « Wagner ou votre démission ! » Et sans souffler, sans se reposer, sans embrasser sa famille, l’aide de camp, marchant toujours devant lui comme un personnage des légendes allemandes, dut s’élancer dans sa chaise de poste et courir après l’auteur du Tannhauser qu’il finit par dénicher à Zurich.
VIII
Wagner devint vite l’ami de son jeune souverain, qui donna à son musicien favori le luxe nécessaire à son tempérament. À Vienne , Wagner fut l’objet, en plein théâtre, d’une ovation sans exemple qui le vengeait bien au delà des insultes des beaux messieurs de Paris. Quand il entra dans la salle, à une représentation de Lohengrin, les spectateurs se levèrent et, pendant dix longues minutes, acclamèrent le maestro. Debout, dans sa loge Wagner pleurait à chaudes larmes, ému jusqu’à défaillir de cet accueil triomphal, qui était une éclatante protestation contre l’injustice de la France.
À son voyage en Russie, Wagner reçut de la princesse Hélène le contrat de propriété d’une charmante maison. Partout on s’efforçait de donner au grand homme, en marques d’honneurs, la compensation des violences dont il avait été l’objet parmi nous. Depuis son départ de Paris, Wagner fit jouer les Niebelungen , Tristan et Iseult et enfin les Maîtres chanteurs.
IX
Nous avons esquissé à grands traits la vie du musicien. Il nous reste à donner quelques détails sur l’homme.
Il suffit de regarder Wagner pour deviner une individualité exceptionnelle. Le front est large et magnifiquement développé, le regard est fin et pénétrant, la bouche est sarcastique ; l’ensemble exprime un mélange de finesse et de bonté.
Profondément spiritualiste dans son œuvre, l’auteur du Tannhauser est matérialiste dans sa vie. Généreux jusqu’à la prodigalité, il aime les beaux meubles et les appartements somptueux, la bonne chère, le champagne et les vins du Rhin pétillant dans le cristal, la nappe éclatante de blancheur sur laquelle ruisselle la lumière des bougies.
En quittant l’avenue Matignon où il habita à son arrivée à Paris, il se fit meubler, rue Newton, un hôtel ravissant qu’il fut forcé bientôt d’abandonner pour un appartement relativement plus modeste, rue d’Aumale.
Balzac travaillait dans une robe de moine. Wagner a une passion pour les robes de chambre en velours, violet ou bleu de roi, que relèvent de grosses torsades d’or. Wagner ne travaille guère que le matin ; il fume d’abord deux ou trois pipes dans un magnifique calumet turc, et se met à écrire, comme Chérubini, debout sur un pupitre à hauteur d’appui Chose étrange ! il ne trace absolument pas une note sur le papier sans avoir tout le morceau dans sa tête. Le chef- d’œuvre sort tout armé du cerveau de ce Jupiter créateur, et telle est sa fermeté de conception, qu’il ne fait pas une rature en cent pages, malgré la complexité des éléments dont se compose son œuvre, malgré la variété des motifs et la richesse de l’orchestration. Ce n’est plus un compositeur, c’est un copiste merveilleux, — un copiste qui ne se trompe jamais.
Wagner est un des plus éloquents causeurs qui existent ; sa conversation roule des idées et des paradoxes comme certains fleuves roulent de l’or. Entre amis, quand le milieu est sympathique et favorable, il monte parfois à de très grandes hauteurs ; il préfère même les sujets les plus abstraits et les plus élevés, et souvent se perd dans les spéculations nuageuses familières aux philosophes allemands. Depuis Goethe, jamais homme de génie ne fut plus égoïste que Wagner, — pas même Victor Hugo. Il y a chez lui un certain développement du sentiment de la personnalité, une profonde conscience de son génie, une irrésistible propension à tout sacrifier à ses idées. C’est le moi haïssable de Pascal dans toute sa naïve effronterie. Ses amis ne sont pour lui que des instruments : il les emploie avec le même sans gêne qu’il emploie les instruments d’un orchestre, pour seconder et accompagner son œuvre. Nul n’a rencontré plus de dévouements, plus de fanatismes, plus de séides enthousiastes et prêts à mourir pour lui. Nul n’a moins reconnu et moins apprécié le dévouement. Cela lui est dû, pense-t-il probablement . Wagner eut-il tous les torts envers Meyerbeer qui du moins le sauva des âpretés de la misère parisienne en lui faisant donner la place de maître de chapelle à la cour de Dresde et qu’il a éreinté à outrance dans le Roman et le Théâtre ? Nous l’ignorons ; mais nous pourrions hélas ! citer vingt exemples qui dénotent une incroyable sécheresse de cœur.
Gounod avait pour Wagner une respectueuse déférence et devant lui gardait l’attitude d’un enfant devant son père, d’un disciple devant son maître. Wagner a écrit sur l’auteur de Faust un article où la grossièreté dans la forme est au niveau de l’injustice dans les jugements… Insolent et hautain dans la prospérité, Wagner a des affaissements profonds dans la défaite. Mais ces affaissements ne durent que quelques jours et font place à une charmante ironie où l’homme d’esprit se raille tout le premier en raillant les autres. Pendant six mois il signa toutes ses lettres : l’auteur sifflé du Tannhauser, et personne ne parlait de ces tristes soirées avec plus de verve et d’entrain.
Doué d’une dévorante activité qui est un peu l’activité d’un hanneton colossal, Wagner manque absolument de savoir-faire, et le nombre des ennemis que ses façons d’agir lui ont créé n’a d’égal que le nombre des amis que son génie lui a conquis.
X
Il nous faudrait d’immenses développements pour donner une idée même incomplète du système wagnérien. Cette étude exigerait un livre tout entier. — Essayons cependant en quelques lignes d’indiquer les points saillants de ce système qui n’a pas encore trouvé de formule esthétique bien précise et bien nette.
On a prétendu que Wagner proscrivait la mélodie, — rien n’est plus faux, — seulement il ne veut pas que la mélodie soit réduite à quelques morceaux entre lesquels il n’y a plus que le vide, il la répand également sur l’opéra tout entier et sur l’orchestre dont il double l’importance et qui devient partie concertante dans l’exécution. Ce que le maître proscrit ce sont les ornements de mauvais goût plaqués à tort et à travers qui détruisent l’unité et l’homogénéité de l’œuvre, ces cavatines, ces soli chantés par une femme ou par un homme qui vient se camper devant le trou du souffleur, ces coupes stéréotypées qui sont des clichés musicaux, — quelque chose comme les songes des tragédies classiques.
Wagner rêve l’union intime du drame et de la musique, le drame appuyé et soutenu par la musique, la musique expliquée par le drame, — le tout relié par une chaîne harmonique non interrompue, — en un mot la tragédie parfaite et complète.
Les compositeurs d’ordinaire ne se préoccupent que de donner à l’oreille un agréable chatouillement, que de produire un bruit plus ou moins heureux et réussi, Wagner prétend s’adresser à l’âme et par un noble réalisme lui procurer de généreuses émotions, lui traduire sous la forme matérielle d’une musique immatérielle le Beau, le Vrai et le Bon.
L’auteur du Tannhauser est en effet profondément spiritualiste. On a discuté longtemps sur la moralité du théâtre ; avec des auteurs comme Wagner cela ne ferait plus même question. La devise de son œuvre pourrait être le mot de Platon : le Beau est la splendeur du Vrai. Le Tannhauser représente la lutte du matérialisme et du spiritualisme, le chevalier chrétien aux prises avec les séductions de la Vénus païenne, — créature du démon et éternelle comme le démon. Lohengrin, sous une autre forme, répond aux mêmes préoccupations qui sont certes les préoccupations d’un esprit autrement élevé que celui de nos compositeurs modernes. Lohengrin c’est l’idéal , l’ange descendu du ciel pour protéger l’innocence et combattre l’iniquité, le Mal. Lohengrin délivre Elsa en lui faisant jurer de ne pas chercher à s’attacher à lui par des liens matériels. Mais Elsa c’est la fille d’Eve ou plutôt c’est Eve elle-même avec sa curiosité diabolique de savoir , de posséder et de jouir. Elle rêve de goûter avec Lohengrin l’ange-chevalier des plaisirs charnels, mais la vision qui a un moment pris la forme humaine se dégage et disparaît dans un char de feu.
Évoquer par l’Art les idées les plus pures et les plus hautes, faire appel aux plus nobles aspirations de l’être humain, substituer aux opéras de carton les drames palpitants du cœur humain, en interpréter par la musique qui est la langue des âmes toutes les impressions et toutes les douleurs, — voilà quelle est l’esthétique de Wagner.
Nous ne savons trop jusqu’à quel point le système wagnérien peut, comme Wagner l’affirme, exercer une influence considérable au point de vue social. Wagner mort et immortel sera-t-il le pontife artistique d’une société idéale régénérée par le retour au christianisme ou ayant trouvé enfin le chemin de cette terre promise de l’humanité qu’ont rêvée tant de grands esprits depuis l’auteur de la République jusqu’à l’auteur du Tannhauser ? Ces œuvres impérissables auront-elles pour les siècles à venir le caractère sacré qu’avaient pour la Grèce la Théogonie d’Hésiode ou les hymnes de Pindare ? Nous ignorons tout cela parfaitement et nous n’avons point à entrer ici dans cet ordre de discussion . Wagner, en tout cas, est le musicien de l’Avenir, et ce titre qu’il prend n’est point un acte d’orgueil, mais l’affirmation d’une foi ardente et légitime. Dans dix ans, — ce qui n’est pas loin dans l’Avenir, — on jouera Tannhauser, Lohengrin, Tristan et Iseult sur toutes les scènes du monde, et la foule ratifiera l’opinion des connaisseurs qui ont proclamé Wagner le plus grand musicien du dix-neuvième siècle.
XI
C’est pour cela encore une fois qu’il nous a paru intéressant d’étudier la physionomie du maître inspiré dont le front s’éclaire déjà du reflet de l’immortalité. Nous avons fait cette étude comme il nous a semblé qu’elle devait être faite, sans parti pris et sans concessions à notre admiration, — loyalement et sincère ment. Il faut accepter certaines défaillances et certaines oppositions entre le caractère et l’œuvre chez les plus admirables et chez les plus illustres. L’écrivain qui apprécie et qui juge n’est point tenu d’avoir la pieuse attention des fils de Noé .
Wagner met son cœur dans son œuvre. Il l’y met tout entier et c’est pour cela, sans doute, comme nous l’avons vu, qu’il lui en reste si peu dans la réalité. Ces sentiments élevés qui inspirent sa musique rappellent Sénèque écrivant l’éloge de la pauvreté en buvant le Falerne dans l’or — L’artiste est grand, l’homme est petit.
Paris , 2 avril 1869
Nous croyons devoir reproduire à la fin de cette étude la lettre adressée par Wagner à Mme Judith Mendès, au moment où l’on parlait de l’arrivée à Paris de l’auteur du Tannhauser. Elle donne une assez juste idée de l’opinion que le maestro se fait de lui-même, et malgré quelque germanisme, elle est vrai- ment belle et d’un noble accent.
Madame ,
Vous avez la bonté de me demander quelques détails sur l’époque de mon premier séjour en France, dans l’intention bienveillante de rédiger à leur aide un article dont la publication coïnciderait avec mon arrivée à Paris, que vous croyez prochaine. En vous remerciant de l’intérêt que vous voulez bien me porter, permettez-moi de vous dire, madame, que je n’ai pas l’intention de me rendre à Paris. Je sais que j’y ai d’excellents, voire même de nombreux amis, et j’espère n’avoir pas besoin de vous assurer que je suis capable d’apprécier la valeur et la portée des témoignages de sympathie dont j’y suis l’objet. Cependant ma présence et ma participation à la représentation qui se prépare, devraient donner lieu à un malentendu. J’aurais l’air de me mettre à la tête de l’entreprise théâtrale, dans le but de regagner par Rienzi ce que j’ai perdu par Tannhauser ; c’est du moins ainsi, sans nul doute, que la presse interpréterait ma venue. Or, la mise en scène de Rienzi au Théâtre-Lyrique, n’a été qu’une question toute personnelle entre M. Pasdeloup et moi. À la suite de la représentation des Maîtres chanteurs à Munich et de l’attention dont elle a été l’objet, plusieurs propositions m’ont été faites. On a d’abord parlé d’une troupe allemande devant donner l’un après l’autre mes six opéras à Paris ; puis on a voulu tenter Lohengrin en italien, puis encore Lohengrin en français, que sais- je ? Bref, il n’était pas question, cet été, de moins de cinq projets concernant la représentation de mes œuvres à Paris. Cependant je n’en ai point encouragé un seul Quand M. Pasdeloup est venu me dire qu’il prenait la direction du Théâtre-Lyrique dans l’intention de donner plusieurs de mes ouvrages, je ne crus pas pouvoir refuser à cet ami zélé et capable, l’autorisation de les représenter ; et, comme il désirait débuter par Rienzi, je lui dis qu’en effet c’était celui de mes opéras qui m’avait toujours paru devoir s’adapter le plus aisément à une scène française. Écrit, il y a de cela trente ans, en vue du Grand Opéra, Rienzi ne présente aux chanteurs aucune des difficultés et n’offre au public parisien aucune des étrangetés des œuvres qui l’ont suivi. Tant par son sujet que par sa forme musicale, il se rattache aux opéras depuis longtemps populaires à Paris, et je crois encore que, s’il est monté avec éclat et donné avec verve, il a chance de succès. Ce succès, je le lui souhaite de tout mon cœur, et plus encore à mon ami M. Pasdeloup, qui, de son plein gré, a vaillamment arboré et énergiquement soutenu ma cause depuis une série d’années ; mais je serais mal avisé de vouloir y contribuer par ma personne. Ma nature autant que ma destinée m’ont voué à la concentration et à la solitude du travail, et je me sens absolument impropre à toute entreprise extérieur. Ou Rienzi fera son chemin sans moi, ou, s’il n’est pas capable de le faire ainsi, mon assistance ne saurait l’y aider, et nous aurions à nous dire que les conditions lui sont défavorables.
Telle est en peu de mots ma façon de voir et la ligne de conduite que je suis décidé, ou pour mieux dire, appelé à suivre en ce qui concerne la représentation de mes ouvrages à Paris, tous tant qu’ils sont. Et veuillez, madame, ne pas voir dans cette réserve le signe d’un dédain déraisonnable, que l’on serait autorisé à prendre pour le masque d’une rancune mal étouffée. Je suis loin de faire fi d’un succès à Paris, et je vous avoue même que j’ai toujours considéré comme une des nombreuses ironies de mon sort, que Rienzi, fait en vue de Paris, n’y ait point été donné alors que cette œuvre de jeunesse avait encore pour moi toute sa fraîcheur. Mais puisque vous me parlez de la renommée que je me suis acquise en Allemagne, permettez moi de vous dire, madame, que cette renommée s’est faite sans ma participation personnelle, par mes œuvres seules, à l’aide de quelques amis, au milieu des huées de la presse entière du Nord et du Midi, et malgré les entraves que ma situation politique opposait à la propagation de mes opéras. C’est ainsi seulement que je désire réussir à Paris, où j’ai trouvé des amis trop dévoués et trop intelligents pour ne pas m’en remettre entièrement à eux du sort de mes œuvres. Si vous me disiez, madame, qu’une représentation conforme à mes intentions, et par ainsi ma présence aux répétitions, serait avant tout nécessaire au succès de l’entreprise, je vous répondrais que Tannhauser et Lohengrin ont été mutilés par la plupart des maîtres de chapelle allemands comme ils ne sauraient l’être davantage sur la dernière scène française, et que ce n’est que depuis que le roi de Bavière m’a accordé sa protection, qu’il m’a été possible de faire connaître mes intentions dramatiques et musicales sur un théâtre important.
Croyez moi, madame, les choses en étant au point où elles en sont, je ne saurais faire autre besogne qu’écrire mes œuvres, et pour ce qui est de leur sort, tant dans mon pays qu’à l’étranger, m’en remettre à leur étoile et à mes amis. Je ne suis pas l’homme des accommodements, et cependant ces accommodements sont parfois indispensables. Je me retire donc, afin de ne pas rendre plus âpre encore à mes amis de France la voie si âpre déjà qu’ils ont choisie en essayant de naturaliser en France une individualité essentiellement germanique. Si cette naturalisation est possible, elle se fera par eux et sans moi ; si elle n’est pas possible, je déplorerai leur peine en me consolant par la pensée qu’eux, aussi bien que moi, ont puisé leurs forces ailleurs que dans l’idée d’un succès, et que leur conviction, pareille à la mienne, les rend indépendants de la bonne et mauvaise fortune.
Veuillez, madame, excuser la longueur de cette explication, et croire à ma reconnaissance et à mon respectueux dévouement.
RICHARD WAGNER. Mars 1869.
1Comme le confirme La Chronique illustrée du 11 avril 1869 qui en fit la réclame
2Les versions sont différentes sur les rapports de Wagner et de Meyerbeer. Selon quelques personnes à même d’être parfaitement informées, Meyerbeer n’était qu’un faux bonhomme qui, pressentant que le génie de Wagner éclipserait un jour le sien, donnait à son compatriote des lettres de recommandation qu’il cachetait toujours avec soin et qui étaient admirablement conçues pour décider tous les éditeurs … à mettre Wagner à la porte.
Nos remerciements à Luc-Henri Roger pour la transmission des documents.