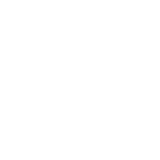Il y a exactement un siècle, les arènes romaines de Vérone accueillaient pour la première fois un opéra. Depuis, l’immense structure offre chaque été le Festival d’Opéra avec des productions spectaculaires, les plus populaires opéras de Verdi, Puccini, Bizet (Carmen), Mascagni, avec une interruption de onze années pendant les deux guerres mondiales et la récente pandémie due au Covid.
La première production en 1913 fut AÏDA de Verdi, dans le style des marches de masse courantes à l’époque, avec des figurants aux costumes exotiques et des décors très élaborés. Le public était particulièrement enthousiaste de voir des éléphants dans la célèbre marche triomphale. AÏDA reste l’opéra le plus joué dans l’arène, devant Carmen et Nabucco, avec pas moins de 736 représentations.
Pour cette édition « anniversaire », c’est une toute nouvelle production qui est proposée, dans un genre très très différent de celui de Zeffirelli, immense metteur en scène, dont on fête d’ailleurs cette année le centenaire. Certes, un immense défi pour l’italien Stefano Poda, que de concevoir une nouvelle version avec toutes celles existantes, directement inspirées des objets de l’Art de l’Egypte ancienne, soit des idées des égyptomanes, sans oublier les productions hollywoodiennes.
Stefano Poda dirige tout : mise en scène, décors, costumes, lumières et même chorégraphie. Dons, pas de reconstitution historique, mais une évocation intemporelle, futuriste, entre Starmania, Le retour de Jedi, d’un monde en guerre où l’on construit d’un côté pour détruire de l’autre.
Le principal élément scénographique est une main monumentale, dressée au fond d’un immense plateau transparent, dont les doigts s’ouvrent et se ferment au gré de l’action. A l’arrière, sur les gradins, à droite, gît une immense colonne corinthienne brisée, et à gauche, la carcasse d’un engin militaire (canon, vaisseau spatial oui sous-marin ????), tous ces accessoires nous rappellent que de tout temps, les conflits charrient leur lot de destructions. On a l’impression que Poda a peur du vide, car il a surchargé ses visions de symboles divers : des momies que l’on promène, des effigies aux poings fermés que le peuple brandit pendant le triomphe. Les mouvements de foule bien réglés certes, perturbent les passages intimistes, et les « pseudos » danses sont franchement sommaires et mal à propos : au premier acte, les nombreux figurants, hommes et femmes, vêtus de noir et blanc, se précipitant sur le sol en verre ressemblant à des pingouins traversant la banquise, ou alors les prisonniers qui surgissent du sol, nus et rampants tels les damnés de Bosch, ou encore cette procession aux flambeaux sur les hauteurs des arènes de Vérone durant le jugement du dernier acte, plus tard figurants et choristes entièrement enveloppés dans du papier aluminium, sorte de tas d’argent brillant, ressemblant davantage à une usine de recyclage qu’à une production d’Aïda… on est très loin de notre idée de l’Egypte pharaonique !!!!
Dans cet espace si vaste, avec cette foule impressionnante (plus de 400 figurants), les chanteurs (une fois de plus) sont souvent obligés de forcer leurs moyens vocaux pour se faire entendre.
Pour cette dernière d’ , c’est la soprano uruguayenne, mais citoyenne véronaise (depuis des années) Maria Jose Siri qui a interprété le rôle-titre. Très convaincante, elle a chanté avec plénitude et une richesse de la voix, atteignant le sommet dans le duo du Nil, ne forçant jamais la voix pour dépasser l’orchestre. Dommage qu’elle fut mal accompagnée par le Radamès poussif et peu vaillant campé par le ténor sud-coréen Yonghoon Lee. Son « Céleste Aïda » fut assez crédible et malgré quelques moments de beau chant, il ne fut jamais à la hauteur des têtes d’affiche. Autre prestation brillante, (pâle Carmen deux soirs avant) fut une Amnéris très convaincante, avec une grande voix impressionnante dans un final où elle impose une autorité naturelle. Malheureusement, elle fut peu aidée par son costume et la mise en scène de Posa. Le baryton Gevorg Hakobyan fut un Amonasro exemplaire de présence et de coffre. Rafal Siwek (Ramfis) et Romano Da Zova (II Ré) ont bien peiné ce soir, accusant une voix fatiguée.
Une mention particulière pour les chœurs de l’Arena, efficaces, très impliqués et, admirablement dirigés par le maestro Roberto Gabbiani.
Le chef Daniel Oren, toujours en excellent professionnel a eu la lourde tâche de diriger les solistes, les chœurs, les musiciens au milieu de cette mise en scène « monstrueuse ». Il a remporté avec assurance et élégance, ce lourd défi.
Somme toute, un spectacle « hollywoodien » auquel Poda a enlevé tout sens historique, tout aspect humain au chef d’œuvre de Verdi, créant ainsi une histoire d’amour avec une abondance de paillettes, l’utilisation de fumée et de sabres laser, et de costumes d’un goût douteux. Je ne pense pas que Verdi aurait apprécié !!!!
Marie-Thérèse Werling