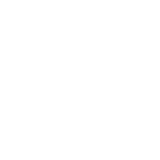Depuis le pontificat de Serge Dorny, l’Opéra de Lyon a coutume de présenter vers la fin de l’automne un opéra en version concertante, généralement proposé ensuite à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Avec l’arrivée de Daniele Rustioni au poste de Directeur musical, dès 2017, le choix de coréaliser cet évènement avec l’Auditorium Maurice Ravel a entraîné son déplacement dans une salle plus adaptée à ce type de prestation. Cela permet aussi aux forces vives de la Place de la Comédie de se produire dans un cadre lumineux, moins dépressogène que l’inénarrable et titanesque gag funeste constitué par la sinistre salle du sieur Nouvel.
Une création locale excessivement tardive
Invariablement cet opéra donné en concert constitue un sommet des saisons artistiques. Tout particulièrement, la remarque vaut sur le plan émotionnel, dans la mesure où les chanteurs (solistes comme chœurs) ne se trouvent plus empêtrés dans les délires psychanalytiques de scénographes névrosés autant qu’incultes. Ainsi, les interprètes peuvent enfin vraiment » jouer » leurs rôles, dans la spontanéité de tous les sentiments à exprimer.
Après le retour distingué d’Hérodiade de Massenet l’an passé1, la création lyonnaise (sic !) d’Adriana Lecouvreur de Cilèa est à marquer d’une pierre blanche, voire d’un diamant.
Vous avez bien lu : il aura donc fallu attendre 121 ans pour que le chef-d’œuvre du compositeur calabrais soit enfin entendu intégralement dans la Capitale des Gaules…
Honte à ma ville natale [exceptionnellement, permettez à votre serviteur d’employer la première personne] pour cette incurie ! Surtout lorsque j’aurai pris le soin de rappeler que, au cours du dernier demi-siècle, Bordeaux, Marseille, Nice, Avignon, Toulouse ou Rouen l’ont imposée scéniquement bien avant Paris et que Saint-Étienne (distante de seulement 65 kilomètres de Lyon) en a déjà proposé deux productions différentes…
Mieux vaut tard que jamais, dit l’adage, et grâces soient rendues : d’abord à Daniele Rustioni pour ce choix précis qu’il a souhaité défendre ; ensuite à Richard Brunel, qui a comme mérite princeps d’afficher – depuis le début de sa direction générale – des œuvres jamais données céans. Et croyez-moi, la liste est encore longue (je suis d’ailleurs à sa disposition sur le sujet).

Jusqu’à quel Parnasse Daniele Rustioni mènera-t-il les mélomanes ravis ?
Précisément, commençons par notre Directeur musical – avec le concours notable d’Hugo Peraldo comme chef assistant pour la préparation soignée de cette production – qui se surpasse une fois encore, au point que l’on peut légitimement s’interroger : jusqu’à quel Parnasse Rustioni mènera-t-il les mélomanes ravis ? Direction nerveuse, dynamique en diable, concernée, impliquée, traduisant une véritable affection pour cette partition relevant du vérisme réformé, courant initié par le Baron Alberto Franchetti, inquiet de la dérive du Vérisme musical pur et dur dont Mascagni fut, dans un premier temps, le fer de lance.
Seule l’introduction de l’Acte I manque un peu de chair, perceptiblement en raison d’un nombre insuffisant de violons I et II. Néanmoins, la phalange trouve vite ses marques, comme si elle avait éprouvé la nécessité d’un échauffement initial. Tout particulièrement, la restitution des principaux leitmotivs – d’abord timide – acquiert un notable relief, que ce soit au sein de leur double fonction, sémantique et structurale (ceux d’Adrienne, de Maurice, de la passion…) ou dans leurs métamorphoses (ceux de la Princesse / Jalousie, de Michonnet, du bouquet de violettes…). Quelques perfectionnements sont encore possibles ; tels les trilles dans la coda du I, encore piètrement nets et francs. En revanche, l’on s’extasie devant une montée en puissance graduelle rejoignant les plus grandes interprétations. Dans les airs et ensembles, l’orchestre sertit les voix comme une pièce d’orfèvrerie. Il atteint des cimes au cœur des passages à découvert, comme l’interlude précédant le finale du II, le ballet du III ou le prélude wagnérien du IV (avec ses pénétrantes réminiscences de Tristan ou Rheingold). Maints pupitres solistes méritent une mention : le 1er violon solo envoûtant de Kazimierz Ołechowski, les 1ers hautbois et clarinette veloutés de Matteo Trentin et Ángel Martín-Mora, la harpe de Sophie Bellanger et l’ensemble des capiteux violoncelles, magistralement menés par Ewa Miecznikowska.

Un affrontement féminin d’exception
En dépit d’interventions majoritairement centrées sur le III (rappel : ils sont absents du II et du IV dans cette œuvre), les chœurs de l’Opéra de Lyon accèdent à un rang enviable sous la direction de Benedict Kearns : celui d’un vaisseau amiral, digne d’avoir pour partenaires les meilleurs solistes internationaux. Or, ceux réunis pour la circonstance nous réservaient sans doute la plus grande surprise du concert.
Remplaçant Elena Stikhina initialement affichée, la soprano américaine Tamara Wilson relève courageusement le défi lancé par le rôle-titre. De cette confrontation, elle sort indemne voire victorieuse ce qui est déjà considérable. Il n’est d’ailleurs pas évident que sa consœur russe eût mieux triomphé qu’elle des pièges nombreux dont Cilèa a parsemé une partition servie avec brio depuis sa créatrice Angelica Pandolfini. À partir des années 1950, les plus grandes cantatrices ont tenu à affronter « L’humble servante du génie créateur » avec des bonheurs divers : Maria Caniglia, Renata Tebaldi, Leyla Gencer, Montserrat Caballé, Renata Scotto, Raina Kabaivanska, Sylvia Sass, Margaret Price, Mirella Freni, Joan Sutherland…etc. Si Maria Callas ne put concrétiser sa légitime aspiration à l’incarner, Adrienne trouva en Magda Olivero sa prêtresse idéale (jusqu’aux dires même du compositeur !). Au gré d’une écriture oscillant sans cesse entre les capacités d’un grand-lyrique et d’un dramatique, l’endurance, la gestion du souffle et la maîtrise absolue dans l’alternance périlleuse du déclamé et du chanté constituent les écueils les plus redoutables, surtout lors d’une prise de rôle. Or, c’est précisément le cas pour Tamara Wilson. Entendue céans en 2016 dans le Requiem de Verdi dirigé par Leonard Slatkin, elle avait déjà retenu notre attention au terme d’une exécution de haute tenue. Faisant ses débuts un peu précipités dans le rôle d’Adrienne, le critique se doit de considérer cet état de fait. Pourtant, nul besoin d’indulgence en fin de compte. L’actrice, d’abord, possède un authentique instinct théâtral, aussi bien dans le jeu du visage, des regards, des mains, que dans les inflexions vocales où elle joue sur les déclinaisons du timbre. Ajoutons à cela l’art d’une prima donna sans chichis, prudente dans le parlando mais respectant à la lettre les indications de la partition (nous l’avons en main aujourd’hui… en cas de trou de mémoire post-covid… !). Cela nous vaut un « Io son l’umile ancella » accompli. Si l’indication piano de « La promessa terrò » du II peut encore se travailler (elle sonne un peu prosaïque), Miss Wilson met toute son ardeur dans l’affrontement avec sa rivale, dans la scène de Phèdre au III et dans un IV sublime de bout en bout : « Poveri fiori » ciselé – soutenu par un orchestre en état second, investi au possible – , des gruppettos à fondre (« La mia corona è sol d’erbe intessuta »), un duo final avec Maurice et une mort simplement mémorables. Quelle artiste riche de promesses, ô combien !

En Princesse de Bouillon, Clémentine Margaine s’inscrit dans la droite ligne de la composition recherchée façon Giulietta Simionato, plus que des calibres surdimensionnés du type Elena Obraztsova ou Fiorenza Cossotto. Captivé par ses prestations entendues en retransmissions radiophoniques, le hasard fit que, jusqu’à présent, nous n’avions pas encore entendu la mezzo-soprano française sur le vif. Or, elle nous comble ! En voie de devenir une vraie mezzo dramatique, elle s’accommode avec une classe exceptionnelle de la terrible partie de contralto dramatique inhérente à la Princesse de Bouillon, optant pour l’alternative la plus ardue lorsque surgit un oppure. « Acerba voluttà » subsume l’opulence de ses moyens : aigu tranchant jusqu’au la aigu forte, médium corsé, graves sans poitrinage artificiel jusqu’au si en-dessous de la portée inclus, sensualité d’une ligne dans l’esthétique néobelcantiste, volume abondant, sens de la valeur des mots avec – aux moments idoines – une légère accentuation vériste non outrancière… du grand art ! Les deux dames dans leur duo atteignent la catharsis : un tel degré de clairvoyance dans la surenchère nous laisse en un état frisant la commotion.

Des messieurs et comprimari qui ne déméritent pas
Brian Jagde surprend agréablement dans un emploi créé par Caruso. S’inscrivant dans la tradition des Maurice de Saxe sombres de timbre (Del Monaco, Domingo, Kaufmann), à l’opposé des ténors à l’émission plus claire – voire ouverte – et cuivrée (Di Stefano, Corelli, Carreras), il affiche des moyens consistants. Les la et sib aigus sont crânement affirmés et on le sent très à l’aise, nullement gêné aux entournures. Néanmoins, éprouvé que nous fûmes par des Maurizio claironnants et bruts de décoffrage (presque soudards !), nous l’attendions au tournant sur le terrain des nuances. Heureuse surprise : celles-ci s’avèrent respectées et scrupuleusement gérées. Si « L’anima ho stanca » s’inscrit moins dans ses meilleurs notes que « La dolcissima effigie », il sait en négocier les périls autant que ceux du Récit de Mittau au III. Le slancio typique de l’époque comme du style répond bien « présent ! ». Reste encore à personnaliser et varier davantage les coloris. Cela viendra, car on pressent un artiste sagace.

Compliments au baryton géorgien Misha Kiria, composant un Michonnet certes guère chenu mais respirant la bonté, profondément humain, projetant bien la voix mais capable des plus tendres inflexions, jusque dans l’ingrat monologue du I. Le falsetto au II se révèle correct – sinon aisé – tandis que les aigus de poitrine sont brillants (des fa et sol bien placés). Au terme du parcours, il rejoint même les plus grands dans ce rôle, dans une synthèse adroite, située entre Giuseppe Taddei (pour l’impact) et Alessandro Corbelli (pour la bienveillance).

Seul à apporter la touche italienne à la distribution, Maurizio Muraro2 campe un Prince de Bouillon désormais anthologique, d’une irrésistible décontraction. Son duo de compères avec l’Abbé de Chazeuil confié à Robert Lewis fonctionne admirablement. Cela s’inscrit d’autant au mérite de ce chanteur qu’il n’a pas encore atteint le statut de vieux routier propre à son partenaire, puisque, soliste du Lyon Opéra Studio, il progresse à chacune de ses apparitions.

Nonobstant un registre grave encore un peu déficitaire, l’intelligence de sa composition augure bien d’un avenir où il pourrait marcher sur les traces d’un Piero De Palma, le plus légendaire parmi les ténors de la catégorie comprimario. Félicitations ! Elles s’étendent aussi à un beau quatuor de comédiens du français, avec les camarades de Robert Lewis : Giulia Scopelliti (Mademoiselle Jouvenot), Thandiswa Mpongwana (Mademoiselle Dangeville), Léo Vermot-Desroches (Poisson) et Pete Thanapat (Quinault), tous d’une musicalité et d’une précision rythmique flagrante dans les ensembles. Il n’est jusqu’au ténor Yannick Berne (artiste des chœurs remarqué de longue date dans des emplois secondaires) qui participe à la réussite de cette entreprise dans la brève intervention du Majordome au III.
Au bilan : une décharge émotionnelle telle qu’elle devient dangereuse pour un vieux critique – même éprouvé –, consacrée par une glorieuse standing ovation, ayant valeur de signe chez un public habituellement plus réservé.
Espérons maintenant Andrea Chénier de Giordano et Cristoforo Colombo de Franchetti !
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN
3 Décembre 2023.
1 Voir article de Patrick Martin, du 23 novembre 2022 https://resonances-lyriques.org/herodiade-de-massenet-a-lauditorium-de-lyon/
2 Déjà présent, comme Alessandro Corbelli, dans l’indispensable DVD de la production de David Mc Vicar avec Angela Gheorghiu et Jonas Kaufmann dirigés par Mark Elder à Covent Garden en 2010 et publié par DECCA.