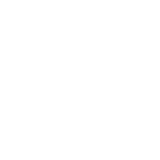Dans le salon quelque peu délabré d’une maison de prostitution à Paris en décembre 1842 un médecin vient visiter les pensionnaires pour s’assurer de leur état de santé. Violetta est atteinte de « phtisie » (en fait la tuberculose, maladie qui était au 19ème siècle mortelle). C’est à cette occasion qu’apparaît le riche Baron Douphol (Roberto Accurso) qui vient sortir Violetta de son univers miséreux afin d’en faire sa maîtresse et la courtisane huppée des salons fastueux de l’époque (on appelait ces femmes entretenues et nanties de divers amants des « demi-mondaines »).
Ainsi commence La Traviata de Verdi mise en scène par Jean-Louis Grinda.

Le décor de ce prologue, qui n’est pas au sens strict dans le livret (l’œuvre s’ouvre en effet sur la brillante fête donnée par Violetta), revient pour partie à la fin de l’œuvre dans un postlude qui clôt ce « flash-back ». Sur le point d’expirer Violetta retrouve, l’espace de quelques secondes, un élan de vitalité sur le mot « rinasce » (« je renais ») et tend ses bras vers les courtisans alignés derrière un rideau de tulle qui l’applaudissent comme si elle retournait à son état premier de courtisane dans cette société artificielle qui pourtant l’a broyée. Au demeurant, Jean-Louis Grinda nous donne à voir de forts belles images (Décors : Rudy Sabounghi / Costumes : Jorge Jara / Lumières : Laurent Castaingt) qui nous plongent dans le romantisme du 19ème siècle en demeurant fidèle à l’esprit du roman d’Alexandre Dumas La Dame aux Camélias. Lorsque Violetta est « achetée » par le Baron Douphol, elle est revêtue d’une sublime robe fuchsia et les murs de la maison close éclatent pour s’ouvrir sur un somptueux salon rouge aux panneaux incrustés de statues d’ivoire.
Cette production de l’Opéra de Monte-Carlo et de l’Opéra de Saint-Étienne en 2013, avait été choisie en outre pour inaugurer le nouveau théâtre d’Anthéa à Antibes voici 10 ans. Violetta était alors interprétée en principauté par la cantatrice bulgare Sonia Yoncheva dont la ressemblance physique (sans doute également en l’état de la coiffure et des robes qu’elle portait) s’avère frappante avec la nouvelle protagoniste, la soprano russe Aida Garifullina. De surcroît, ces deux artistes ont abordé le rôle l’une à 31 ans et l’autre à 35 ans. Peu de temps après sa Violetta, Sonia Yoncheva chantait Juliette dans Roméo et Juliette de Gounod à l’Opéra d’Avignon, un emploi habituel de soprano lyrique pouvant faire preuve de légèreté notamment pour la valse du premier acte. Dix ans plus tard, Sonia Yoncheva est devenue une soprano dramatique abordant des emplois beaucoup plus lourds comme par exemple Aïda, Manon Lescaut, La Gioconda. Si l’on contemple la biographie d’Aida Garifullina, on constate que celle-ci s’est essentiellement consacrée aux héroïnes mozartiennes ou belcantistes (légères) comme Adina de L’Elixir d’amour ou encore Norina de Don Pasquale. Chez Verdi, elle a seulement abordé Nanetta de Falstaff. A l’écoute de ce que nous avons entendu et compte tenu de ses moyens, nous pensons qu’elle évoluera dans le temps comme son aînée vers le répertoire de grand lyrique. En effet, la voix possède aujourd’hui indubitablement une largeur suffisante lui permettant de maîtriser Violetta sous tous les aspects par des aigus faciles qu’elle peut élargir avec aisance dans le haut registre. Elle est en outre dotée d’un médium déjà ample qui pourra encore se développer au fil du temps en fonction des rôles abordés. Elle a eu le discernement d’attendre l’âge et le temps qui convenaient avant d’aborder Violetta, avec la prudence nécessaire, sans tenter de forcer ses moyens naturels et en faisant abstraction, comme nombre de ses consœurs, du contre-mi bémol qui conclut le premier acte. L’incarnation du personnage est parfaitement cernée et crédible et les qualités de la musicienne sans failles.

Pour beaucoup d’amateurs d’opéra de notre région Javier Camarena était une découverte dans une œuvre lyrique. Il n’était en effet venu à Monaco qu’en janvier 2021 (en pleine crise du Covid) pour un concert consacré à Rossini, Zingarelli et Garcia. Le ténor mexicain s’est produit sur les plus grandes scènes internationales dans un répertoire belcantiste dont il s’est fait une spécialité (Les Puritains, Don Pasquale, La Fille du Régiment) avec un aigu défiant les cimes, à la manière d’un Alfredo Kraus ou encore d’un Juan-Diego Florez. Pour lui aussi il s’agissait d’une prise de rôle et on l’attendait avec une certaine curiosité en Alfredo Germont qui est d’une toute autre couleur et texture que son répertoire habituel. On a été frappé par l’ampleur de la voix et si on s’attendait évidement à ce qu’il soit brillant dans le passage le plus belcantiste de l’œuvre, à savoir la cabalette de l’acte II « Possente, amor mi chiama » (et il le fut ô combien !) mais il nous a de surcroît convaincu par son engagement dramatique tout au long de l’œuvre. Ses duos en parfaite osmose musicale avec sa partenaire furent des moments de grâce et d’émotion musicale.

Quant à Massimo Cavalletti, déjà entendu sur cette scène dans Sharpless de Madame Butterfly, il dessina un sobre et convaincant Alfredo Germont.

Une fois de plus, on s’est émerveillé de la qualité du chœur monégasque et bien entendu de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction très attentive aux protagonistes de Massimo Zanetti. Un des moments forts de la représentation a été également la chorégraphie très attachante et particulièrement galvanisante d’Eugénie Andrin, qui en est également la remarquable protagoniste, en quelque sorte un double de Violetta maltraitée et brutalisée par les hommes et passant successivement dans les bras des uns et des autres.
Encore une fort belle soirée monégasque à mettre à l’actif de la nouvelle directrice de l’Opéra, Cecilia Bartoli.
Christian Jarniat
23 mars 2023