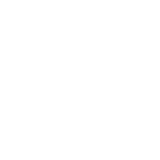Juste avant le premier grand confinement, Yannick Nézet-Séguin avait électrisé le public du théâtre des Champs-Élysées avec une Frau ohne Schatten inoubliable (Van den Heever, Lindstrom, Gould, Volle, Schuster) ; deux ans plus tard, son prologue de la Tétralogie annonçait un cycle tout aussi enthousiasmant : Michael Volle, Wotan bouillonnant, juvénile et insolent, emportait dans son sillage une superbe distribution, équilibrée et sans faille.
Nous voici donc deux ans plus tard, à nouveau, pour la suite du cycle, avec la première journée.

Disons-le d’emblée, cette soirée a frôlé le bonheur absolu… sans l’atteindre. Pour entrer au Walhalla par la grande porte, il aurait fallu un Wotan à la hauteur des exigences redoutables de son rôle. Volle n’aurait pas pu affronter cette tessiture bien trop basse pour sa voix prodigieuse de heldenbaryton ; mais n’y avait-il vraiment aucun autre artiste capable de mieux tenir cette partie cruciale que Brian Mulligan ? Le chanteur affiche une belle sensibilité, et son implication procure çà et là diverses émotions. Mais dès son entrée, la voix présente des strates disjointes : un grave au grain sombre, un médium projeté et fauve mais un aigu très clair – jusqu’à une nasalité assez laide – émis en force, avec moult contorsions et une pression telle que le chanteur s’empourpre systématiquement dès le mi. De surcroît, toute la zone aiguë recule au point que le chanteur disparaît dans la masse orchestrale. Le spectateur passe ainsi sans cesse d’une écoute apaisée et émue à une tension pénible, voire à une déception franche, à l’échelle de toute la représentation comme du seul morceau de bravoure des « Adieux », lequel ressemble davantage, dans ces conditions, à un parcours du combattant perdu d’avance. Comment un chanteur peut-il présenter d’aussi lourdes failles techniques compte tenu de sa formation (Julliard School) et de ses engagements sur les plus grandes scènes internationales ? Cette vraie faute de casting avive d’autant plus de regrets que tous les autres interprètes s’avèrent époustouflants !

Cantatrice chérie du chef québécois, Elza van de Heever ne cesse de grandir au fil de la représentation : au premier acte, son soprano « blond » cultive jusqu’à « Der Männer Sippe » rondeur et luminosité, dans la filiation historique d’une Rethberg, sans toutefois donner un poids suffisant aux mots et au registre grave pour que cette lumière puisse s’ancrer dans une chair brûlante de désir, à l’instar de ce que Rysanek obtenait au plus haut degré. Mais il suffit que la tessiture s’élève à partir de « Du bist der Lenz » pour que sa voix s’enflamme et que l’interprète se libère. Au second acte, les délires du personnage prennent une pugnacité nouvelle : la voix garde son scintillement tout en produisant des reflets cuivrés superbes. Enfin, ce parcours sacrificiel aboutit à un 3e acte juste sublime : nouée, la cantatrice apparaît transfigurée dès son retour sur scène : elle attaque « O hehrstes Wunder » les larmes roulant sur ses joues ; la voix envahit alors la salle comme un torrent et des lames de feu dominent la masse orchestrale tout en gardant pudeur et sensualité. Un prise de rôle – rétroactivement la retenue observée pendant la première moitié de l’acte initial se comprend par cet apprivoisement d’un rôle qu’il faut savoir maîtriser jusqu’au paroxysme conclusif – parfaitement réussie et dont la montée en puissance palier par palier abolit toute réserve.

Solomon Howard, fier d’arborer une plastique athlétique dans des tenues de plus en plus dénudées, propose le Hunding attendu avec sa voix ample, au grain gras et au phrasė direct – avec les quelques nuances venimeuses demandées par Wagner. Les huit walkyries forment de leur côté un groupe démentiel, d’une niveau vocal d’exception, attentives au mot, aux indications musicales, aussi présentes scéniquement qu’émotionnellement. Leur timbre de voix singulier éveille sans cesse l’oreille tout en créant une harmonie générale ; ce sont toutes des musiciennes – certaines possèdent même une aura d’artiste et je ne serai pas étonné de lire certains noms dans de futures distributions pour des rôles de premier plan. Étourdissantes ! Elles sont grandement responsables de l’élan formidable donné au 3e acte.

Cela permet ainsi à Tamara Wilson de parachever une performance en or pur – même si la tenue portée par la cantatrice, tout à fait en situation, la ceint d’argent. Voir une cantatrice arriver sur scène et se lancer dans les « Hojotoho » le sourire aux lèvres, avec des contre-ut aussi faciles, une émission aussi libre, une clarté de timbre aussi cristalline et une telle ampleur ne s’entend ni ne se voit pas beaucoup dans une vie de lyricophile. Le type vocal pourrait faire craindre une annonce de la mort écrite dans de mauvaises notes, mais il n’en est rien ! Aussi à l’aise dans le registre grave que dans des aigus dardés comme des javelots, la Wilson se révèle également remarquable dans les épanchements lyriques et la messa di voce du « Der diese Liebe » que dans l’invective ou l’héroïsme. Sans doute le verbe n’est-il pas encore suffisamment sculpté mais la cantatrice s’efforce de colorer sa voix en fonction des affects, et son implication émotionnelle atteint des sommets au 3e acte.

Stanislas de Barbeyrac aborde de son côté, au seuil de la quarantaine, son premier Siegmund intégral – après un essai pour le seul acte I. Pari réussi haut la main. Mais peut-on parler de virage quand tout ce qu’on entend s’impose comme une évidence ? Le ténor est là où il doit être ! C’est l’adéquation idéale d’une voix et d’un rôle. Très investi sur le plan affectif, soucieux de dire son texte autant que de le chanter, l’interprète multiplie les prouesses de ligne, de nuances, de longueur de souffle, notamment dans un « Winterstürme » aux phrases infinies absolument inouïes. Si De Barbeyrac consentait à ouvrir un peu certaines voyelles aiguës pour leur donner plus d’espace et leur offrir plus de squillo, il gagnerait encore en projection dans la partie supérieure de sa voix – le reste affichant un airain splendide sans cassure de graves barytonnants à un haut médium dense, mâle et d’une séduction immédiate. Du grand art et une préparation qui honore le chanteur français, au milieu de cette équipe internationale.

Reste, en ce qui concerne la distribution, la Fricka de Karen Cargill. Une fois passée une première phrase qui a trahi un certain trac… la cantatrice a produit la plus forte impression de la soirée. Sa présence sur le plateau – elle est la seule à vraiment pouvoir se désolidariser de son pupitre, walkyries exceptées – démontre une maîtrise totale du texte et des enjeux dramatiques, laquelle se retrouve dans sa diction mordante, sa projection du texte, dans une palette incroyable de colorations et de variations dynamiques. À cela s’ajoute un timbre capiteux, un volume vocal de grande ampleur, une longueur de tessiture qui semble n’avoir aucune limite – jusqu’au plaisir d’entendre des notes poitrinėes félines et pugnaces. Sa grande scène du II restera ainsi comme le plus grand moment d’une soirée pourtant festive et riche en émotions diverses !

Quant au maestro, à la tête d’un Rotterdams Philharmonisch Orkest non exempt de fragilités côté cuivres, mais qui dispose d’un groupe de vents et de bois de toute beauté ainsi que de cordes impliquées et à la belle couleur collective, il attaque la représentation un peu prudemment, mais rassemble ses troupes orchestrales pour mettre le feu au duo Siegmund/Sieglinde ; puis, sur cette lancée, il affiche sa conception du II comme une sorte d’arc inversé avec un début tonitruant puis une grande zone étale (récit de Wotan-annonce de la mort) pour terminer en tourbillon ; le III, enfin, démarre sur les chapeaux de roue puis prend, à partir du duo père-fille, des couleurs plus automnales, un lyrisme vespéral avant de déboucher sur un embrasement final crépitant et irrésistible. Une fois encore, sans l’apport de la scène, Nėzet-Sėguin fait pourtant jaillir des images qui s’animent par le seul jeu de la musique, dirigée comme il se doit avec un sens infaillible du théâtre lyrique. L’architecture qu’il a construite a ainsi permis aux chanteurs de trouver, malgré la présence des pupitres, le ton juste, le rythme juste, l’élan d’une représentation d’opéra au sens plein du mot.
Une soirée fêtée par un public aux enthousiasmes si débordants qu’ils englobèrent – à sa propre surprise – Wotan dans des gratifications généreuses et bruyantes – et, à nos yeux, imméritées pour ce seul cas.
Laurent Arpison
4 mai 2024

Siegmund : Stanislas de Barbeyrac
Sieglinde : Elza van den Heever
Wotan : Brian Mulligan
Brünnhilde : Tamara Wilson
Fricka : Karen Cargill
Hunding : Soloman Howard
Gerhilde : Brittany Olivia Logan
Ortlinde : Justyna Bluj
Waltraude : Iris van Wijnen
Schwertleite : Anna Kissjudit
Helmwige : Jessica Faselt
Siegrune : Maria Barakova
Grimgerde : Ronnita Miller
Roßweiße : Catriona Morison
Direction musicale : Yannick Nézet-Séguin
Rotterdams Philharmonisch Orkest