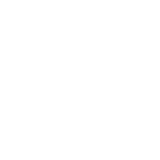Une rencontre historique que nous relate Luc-Henri ROGER :
Le marchand d’art, galeriste, éditeur et écrivain français Ambroise Vollard (1866-1939) fréquenta le peintre Auguste Renoir, qui fit son portrait. Vollard lui consacra deux ouvrages. Dans le premier de ces livres il rapporte des conversations qu’il tint avec Renoir. Voici les pages qui citent les propos du célèbre peintre sur sa visite de Wagner à Palerme au début de l’année 1882 et le rapide portrait qu’il en fit, puis sur le court séjour de Renoir à Bayreuth où il assista à une représentation de la Walkyrie, qui le « rasa » au point qu’il quitta la salle…
— Moi [Ambroise Vollard]. Comment avez-vous été amené à faire le portrait de Wagner ?
— RENOIR. J’étais à Naples, lorsque je reçus des lettres de wagnériens de Paris, dont Lascoux, le juge d’instruction, un de mes meilleurs amis. Ils me pressaient de faire tous mes efforts pour rapporter au moins un croquis d après Wagner.
Je me décidai à aller à Palerme, où il se trouvait alors, et, m’étant rendu à son hôtel, j’eus la chance d’y rencontrer un jeune peintre des plus aimables, un certain Jonkofsky [sic, pour Joukowsky]. Celui-ci suivait Wagner dans tous ses déplacements, pour tâcher de faire son portrait, et, en attendant, lui brossait les maquettes pour ses décors. Ce Jonkofsky m ‘apprit que, pour le quart d’heure, Wagner ne voyait personne, très occupé à terminer l’orchestration de son Parsifal. J’obtins, du moins, de mon confrère, qu’il me préviendrait lorsque Wagner aurait terminé son travail. Quand je reçus le mot si attendu de Jonkofsky me disant qu’il allait me présenter à Wagner, je m’aperçus que j’avais égaré les lettres de recommandation que mes amis m’avaient fait envoyer de Paris… Je me risquai, tout de même, à me présenter les mains vides ; sauf que j’avais emporté ma boîte à couleurs. Les premières paroles de Wagner furent : — « Je n’ai qu’une demi-heure à vous donner ! »
Il croyait, par là, se débarrasser de moi ; mais je le pris au mot. Pendant que je travaillais, je faisais tous mes efforts pour l’intéresser, en lui parlant de Paris. Il en voulait beaucoup aux Français, et ne cachait pas son sentiment là-dessus. Je lui dis qu’il avait avec lui l’aristocratie des esprits. Il en fut très flatté : — « Je voudrais beaucoup plaire aux Français, mais je pensais jusqu’à présent que, pour leur plaire, fallait-il faire une musique de juif allemand ! (Meyerbeer). »
Après vingt-cinq minutes de pose, Wagner se levant brusquement : — « C’est assez ! Je suis fatigué. »
J’avais eu le temps de terminer mon étude, que je vendis par la suite à Robert de Bonnières. J’en ai fait une copie qui a figuré à la vente Chéramy. Le portrait de Palerme date de 1881, l’année qui a précédé la mort du musicien.
— Moi. Et vous n’avez rencontré Wagner que cette fois ?
— RENOIR. Oui, mais si je n’ai guère connu personnellement’ Wagner, j’ai, du moins, été très lié, avec quelques-uns des premiers « pèlerins » de Bayreuth, comme Lascoux, Chabrier, et Maître, dont je vous ai parlé.
— Moi. Et Saint-Saëns ?
— RENOIR. Je ne l’ai pas connu. Il paraît qu’à un moment donné il n’y avait pas wagnérien plus fervent.
— Moi. M. Maître, précisément, racontait à Wyzewa qu’en 1876, se trouvant à Bayreuth, dans une brasserie, avec Saint-Saëns, il s’était permis d’insinuer que la Tétralogie avait peut-être quelques longueurs… Saint-Saëns, en entendant cette critique si anodine, brisa son verre sur la table et quitta la salle…
— RENOIR. En tout cas, pour le quart d’heure, Saint-Saëns a l’air de « débiner » fortement son ancien patron. On m’a lu un article de lui dans un journal de Nice…
— MOI. J’ai rencontré chez Wyzewa le directeur d’une revue musicale, un M. Ecorcheville, si je ne me trompe, lequel tenait d’un ami de Saint-Saëns le récit de la brouille survenue entre celui-ci et Wagner. La scène se passait également à Bayreuth, mais, cette fois, dans la maison de Wagner, où la frénésie du culte de Saint-Saëns pour le musicien allemand lui avait valu d’avoir ses entrées. Un soir, Madame Wagner ayant demandé à l’élève français de jouer quelque chose, sur le piano du grand salon, de Wahnfried, Saint-Saëns attaqua sa Marche funèbre écrite en l’honneur d’Henri Regnault. Sur quoi Wagner, par malice amicale, — ou peut-être innocemment, — de s’écrier : — « Ah ! une valse parisienne ! » Et prenant par la taille une des dames de l’assistance, il s’était mis à tourner autour du piano !… Mais, vous-même, monsieur Renoir, je ne vous ai pas demandé si vous étiez très emballé sur Wagner ?
— RENOIR. J’ai beaucoup aimé Wagner. Je m’étais laissé prendre à cette espèce de fluide passionné que je trouvais dans sa musique ; mais, un jour, un ami m’a conduit à Bayreuth, et dois-je dire que je me suis royalement rasé ? Les cris des walkyries, c’est très bien pour commencer, mais, si cela doit durer six heures de suite, c’est à devenir fou, et je me souviendrai toujours du scandale que je causai quand, dans l’excès de mon énervement, je fis craquer une allumette avant d’être sorti de la salle. Je préfère décidément la musique italienne ; c’est moins « pion » que la musique allemande. Beethoven lui-même a parfois un côté « professeur » qui m’horripile. Et, encore, rien ne vaut un petit air de Couperin ou de Grétry, n’importe quoi, de la vieille musique française. Voilà qui est bien « dessiné » ! Je ne fis donc pas long feu à Bayreuth. Au bout de trois jours, j’en avais par-dessus la tête, et j’éprouvais le besoin de m’offrir en dédommagement quelque chose d’un peu « chouette ». Si bien qu’un beau matin, je pris le train pour Dresde où, depuis longtemps, je désirais voir le grand tableau de Vermeer de Delft, La Courtisane. Malgré son titre, c’est une femme qui a l’air de la plus honnête des créatures. Elle est entourée de jeunes gens dont l’un lui met la main sur la poitrine, pour qu’on voie bien que c’est une courtisane, une main pleine de jeunesse et de : couleur, qui se détache sur un corsage jaune citron, d’une puissance…
Source : Ambroise Vollard, Auguste Renoir, (Paris), G. Crès (Paris), 1920, pp. 117 à 121