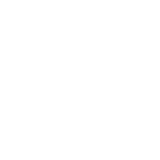« Plus que tout autre compositeur, Bruckner excelle dans l’art de dépeindre musicalement l’infini du temps et de l’espace » (Herbert Blomstedt)
Une clarté céruléenne, la transparence azurée des montagnes de la Haute-Autriche, avec l’indicible mélancolie d’une fin d’été… C’est ainsi que le trémolo des violons du premier mouvement de la Septième Symphonie de Bruckner élève l’auditeur vers des sommets dégagés et grandioses. Herbert Blomstedt, 96 ans, assis, sculpte avec grâce cette cathédrale sonore, la plus célèbre et la plus accessible de toutes les symphonies du Maître de Saint Florian. Il propose ce soir la nouvelle édition critique de la partition récemment publiée par Paul Hawkshaw. L’on peut se satisfaire de ce choix philologique – même si Blomstedt a conservé le coup de cymbales du climax de l’Adagio (sujet de moult querelles musicologiques !) – car Paul Hawkshaw a passé des années à Vienne à étudier le manuscrit autographe de la Septième. Ce soir, nous entendons la symphonie telle qu’elle résonna quand elle reçut un véritable triomphe le 30 décembre 1884 à Leipzig. On est tout de suite subjugué par la texture allégée de l’un des plus prestigieux orchestres brucknériens du monde, l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, alors que Bruckner jouit encore parfois d’une réputation de lourdeur massive. Il n’en est rien, et Blomstedt est certainement aujourd’hui le meilleur ambassadeur de ce compositeur, auquel il sait rendre justice, par sa probité philologique, mais aussi désormais, son engagement spirituel, sa hauteur de vue, en un mot : sa sagesse.

Le Bruckner de Blomstedt respire, il est allégé, juvénile même : il faut voir comment le chef arrive à son pupitre, l’œil malicieux, joueur, parfois espiègle. Il nous place loin du Bruckner romantique pâteux tant décrié dans nos contrées, où sa présence au concert est encore trop rare. Adoptant un tempo giusto (Allegro moderato), Herbert Blomstedt sait se montrer véhément et parfois épique, aidé en cela par des cuivres puissants à la tenue exemplaire. Il est saisissant de voir comment le chef obtient absolument tout de ses musiciens par une économie de moyens, une gestuelle sobre, ce qui n’est pas antinomique d’une belle expressivité, et même d’un certain lyrisme. Le chef se place au service de la musique, partition fermée posée sur le pupitre, maîtrisant les moindres nuances qu’il obtient par sa seule présence : des brucknériens de cette envergure, il y eut Bernard Haitink ou Günter Wand, qui savaient qu’il faut toute une vie pour atteindre un tel degré de dépouillement simple, une éloquence économe, une humilité et une sobriété qui servent l’œuvre et son compositeur. Avec l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, très typé, on est à la fois dans la beauté sonore, comme l’attestent les cordes, soyeuses, et la prise de risques, la puissance racée, proche du Philharmonique de Berlin.

Mais ce qui frappe surtout, c’est la dimension wagnérienne de la vision proposée par Blomstedt : c’est peut-être même cette symphonie qui devrait recevoir le surnom associé généralement à la Troisième Symphonie, la « Wagner Symphonie » car ici, plus d’une fois, on se surprend à entendre le Maître de Bayreuth. Les bois et les cuivres sont équilibrés, le paysage intimiste de certaines pages du Ring est bel et bien présent, notamment dans l’usage de la clarinette, du hautbois (mais certes pas du cor anglais). On passe des bruissements de la forêt aux glorieux tutti cuivrés, notamment le point d’orgue en mi majeur, grandiose zénith exécuté avec une majesté grisante et imposante.
On sait que le premier mouvement de la Septième était terminé en juillet 1882 quand Bruckner se rendit à la première de Parsifal, où il avait remarqué l’état d’épuisement du compositeur de Tristan. C’est alors qu’il commença à composer l’Adagio, comme s’il avait eu la prémonition de la fin prochaine de celui qui allait en effet mourir à Venise : « un jour, je rentrai chez moi très abattu ; je sentais que le Maître n’avait plus longtemps à vivre : et l’Adagio en ut dièse me vint à l’idée », écrivit Bruckner dans une lettre de mai 1885. L’influence est manifeste, puisque Bruckner insère un quatuor de tubas wagnériens pour la première fois dans son œuvre symphonique. Avec Blomstedt, voilà un Adagio plein de cette belle lumière chatoyante, éclats de chaude luminosité derrière les vitraux d’une belle cathédrale, assumant son hommage au Maître de Bayreuth, mais sans pathos excessif. Nous sommes davantage dans la berceuse nostalgique du Requiem allemand de Brahms. Le chef maintient une certaine vélocité, sans alanguir le trait, dessinant comme des vagues, leur flux et reflux, dans une belle gestuelle de la main droite. Rien d’élégiaque donc au début, mais une palpitation, les percussions rythmant avec pudeur les battements d’une âme triste. L’ensemble est d’une élégance altière et d’une beauté confondante. L’orchestre se plie à merveille aux intentions du chef, jouant ici sur le calme, le repos. Blomstedt sait simplement se rendre attentif aux richesses de la partition et à ses héritages multiples. A la fin de l’Adagio, quelque chose se creuse, de plus profond, et dans une gestuelle plus saccadée, le chef obtient de nouveau un tutti de cuivres, brillants et imposants ; l’orchestre se pare alors d’un éclat héroïque, une véritable apothéose de marche funèbre, aidé par le célèbre coup de cymbales et du trémolo du triangle. Des murmures de la forêt (en mi majeur, comme la symphonie !) au bûcher spectaculaire de la fin de ce mouvement, l’auditoire est convié à un voyage sonore passionnant, guidé par le Wanderer Blomstedt. Le mouvement s’achève dans un vaporeux solo de flûte (quelle grâce !) et de pizzicati, rejoints par les mélancoliques tubas qui reprennent la plainte initiale, dans une ambiance alpestre sereine qui guide le Maître au ciel des idoles. On n’oublie pas que le dédicataire de la Septième Symphonie n’était autre que Louis II de Bavière…
Le troisième mouvement, Scherzo, haletant, offre un vrai contraste, une course à l’abîme, voire un Purgatorio. On hésite entre l’air populaire des Ländler caractéristiques de l’écriture brucknérienne et les questionnements sardoniques sur l’au-delà, dans des visions torturées qui anticipent sur le bruit et la fureur mécanistes de la Neuvième Symphonie. Avec Blomstedt, la parenté avec la célèbre Chevauchée des Walkyries devient évidente, même si les rythmes (ternaire pour l’une, binaire pour l’autre) et la structure diffèrent, il y a malgré tout quelque chose de l’ordre de la cavalcade post-mortem claudicante de guerrières ramenant les âmes des héros valeureux morts au combat, notamment dans la sonnerie appuyée des trompettes. Les violons ne ménagent pas leurs efforts : l’engagement physique est total, les archets luttent, les regards complices et les mouvements des musiciens montrent la foi qu’ils mettent dans l’exécution de cette page littéralement exténuante.
Après la traversée dantesque des ombres du Scherzo, on retrouve la lumière du début de la symphonie (même tonalité de mi majeur), dans une forme de soulagement, traversé par quelques alanguissements de Venusberg, force motrice vitale, qui marque la victoire de la musique sur la mort. Le Paradis est bien là qui ouvre ses portes. Le Bruckner de Blomstedt est passionnant en raison de cette dynamique qu’il insuffle, loin du hiératisme marmoréen du Klemperer des dernières années ou des infinis himalayesques d’un Celibidache. Ici, la progression est sans cesse soutenue par les cordes, dans une motricité qui rappelle la marche du Wanderer. C’est bien un parcours, voire une quête spirituelle.

L’équilibre est parfait, en somme : Blomstedt saisit le mélange de sérénité spirituelle et d’épopée propre à cette symphonie dans un hymne à la musique aux accents triomphants, tout s’achève par une nouvelle apothéose, suscitant un silence émerveillé et recueilli avant la méritée standing ovation. Il faut alors voir avec émotion le Maestro, guidé par son premier violon, revenir à quatre reprises saluer, radieux, et l’œil toujours malicieux, un public conquis et admiratif de l’art du maître, avec un orchestre qui lui est cher, dans une nouvelle soirée lucernoise où bat le cœur de la musique avant d’entrouvrir les portes du Valhalla : nous attendons avec impatience le bicentenaire de la naissance de Bruckner en 2024 !
Philippe Rosset
1er septembre 2023
Article disponible en anglais par le lien suivant : http://www.resonances-lyriques.org/fr/chronique-detail/chroniques-musique/1477-concert-hall-lucerne-leipzig-gewandhaus-orchestra-bruckner-blomstedt.cfm