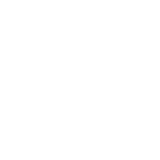Ce qui frappe de prime abord, c’est la belle apparence de datcha perdue au fond des bois de mélèzes que revêt cette formidable salle de la Grange au Lac à Evian, imaginée il y a près de trente ans par l’architecte parisien Patrick Bouchain, voulue comme un cadeau d’Antoine Riboud à Rostropovitch. A l’intérieur, une scène entourée de bouleaux, une odeur boisée, tout invite à la rêverie musicale nordique dans un cadre alpin. Ce soir, place à Beethoven, dans un programme très classique interprété avec fièvre et engagement par le Mahler Jugendorchester sous la baguette de Daniel Harding. Une soirée triomphale, gorgée de vie et d’optimisme sous l’œil complice de Martha Argerich.

Un Concerto n°1 pour piano et orchestre de Beethoven élégant, vivant, mozartien
Tout a été déjà dit au sujet de Martha Argerich, et il semblera ici superflu d’ajouter l’éloge aux éloges. Le Concerto pour piano et orchestre n°1 en ut majeur op. 15 est une œuvre de prédilection pour la pianiste, qui avait gravé un très beau disque avec le regretté Giuseppe Sinopoli il y a quelques années. En concert, il n’est pas rare de l’entendre dans ce répertoire, comme l’atteste le concert de 2019 dirigé par Gábor Takács-Nagy avec le Franz Liszt Chamber Orchestra. Néanmoins, ici, loin d’entendre une œuvre routinière, on retiendra avant tout l’osmose évidente entre la pianiste, le chef et les jeunes musiciens. L’allegro con brio n’a jamais aussi bien porté son nom, où l’on entend les insolences souriantes de Mozart et de Haydn, relayées par l’espiègle jeu de Martha Argerich. Le sens des nuances, partagé par un orchestre totalement engagé, précis et discipliné, nous plonge dans un univers virtuose et sensible. Le hautbois de Joey Bormans séduit immédiatement par sa perfection éthérée et son sens du dialogue avec la pianiste. Trilles et variations rythmiques semblent être exécutés avec une facilité qui se joue de toutes les contraintes techniques. Le tapis sonore de l’orchestre, aidé par la direction toujours aérienne de Daniel Harding, donne le ton d’une grande soirée musicale. Le deuxième mouvement, Largo, révèle des moments éthérés de pure magie. On croirait déjà entendre l’émotion du Concerto n°5 ici. Douceur, élégance, intelligence, technique, il semble impossible de trouver des qualificatifs adéquats pour caractériser le génie pianistique de Martha Argerich. C’est ici la quintessence d’un art maîtrisé qui prend tous les risques qui s’exprime, osant des lenteurs dignes d’un Richter dans certaines sonates de Schubert. L’orchestre, toujours clair et symbiotique, est merveilleux de poésie et de sève juvénile, et, maintes fois, on croit voir passer le spectre de Claudio Abbado, dans chaque pianissimo, avec une Argerich souveraine, et d’authentiques moments de suspension du temps. Quel contraste avec le troisième mouvement, Rondo-Allegro, primesautier, pris à une vitesse étourdissante, avec un hautbois toujours impeccable et la flûte de Marta Chlebicka, accompagnant avec bonheur une pianiste au sommet de son art, suscitant même des sourires communicatifs dans l’orchestre, ravi. Ce mouvement a décidément la verve, la vivacité et la fulgurance d’une ouverture de Mozart, c’est ébouriffant dans le style et la manière. Après un tonnerre d’applaudissements, nous avons droit à un bis désormais traditionnel, proposant une alliance étonnante, des extraits des Kinderszenen de Schumann et de la Sonate K. 141 de Scarlatti, joués coup sur coup, un Scarlatti plein de poésie et de romantisme insoupçonné. Nouveau triomphe du public enthousiaste.

Une 7e Symphonie de Beethoven triomphale et gorgée de sève
Le premier mouvement de cette 7e Symphonie apparaît, sous la baguette du chef anglais, comme la suite logique de la Pastorale, impression renforcée par l’impérial hautbois, qui nous laisse savourer des moments d’apaisement, beaucoup de sérénité automnale et des bruits de nature. Harding est toujours à son aise quand il s’agit de se laisser aller à une forme de rêverie bucolique, rejoignant les propos de Berlioz qui avait parfaitement perçu cette filiation entre les deux symphonies : « J’ai entendu ridiculiser ce thème à cause de son agreste naïveté. Probablement le reproche de manquer de noblesse ne lui eût point été adressé, si l’auteur avait, comme dans sa Pastorale, inscrit en grosses lettres, en tête de son allegro : ronde de paysans ». En dépit de cordes parfois un peu vertes, c’est une vision très scandée, rythmée et dansante qui s’impose ici, avec un Daniel Harding rappelant Bernstein dans son engagement physique, ne faisant que donner raison à Wagner qui avait dit au sujet de cette symphonie que Beethoven avait dépeint « le corps en musique, mettant en œuvre la fusion du corps et de l’esprit ». Le deuxième mouvement, attendu, popularisé par le cinéma, est toujours délicat à négocier, pour ne pas sombrer dans un pathos de mauvais aloi ou une anticipation des marches funèbres mahlériennes. De fait, il apparaît comme le petit point faible de la soirée : on sent une application assez scolaire, un brin d’affectation et de maniérisme, un manque de force spirituelle, sauf dans quelques beaux passages, à la fin, où l’on entend un choral joué pianissimo, avant réexposition du thème principal. Les deux derniers mouvements en revanche corrigent cette impression. Le 3e mouvement, Presto, joyeux, énergique, pousse les jeunes virtuoses dans leurs retranchements. On gagne en théâtralité et en hauteur de vue, avec des passages très chantants, qui laissent percevoir un meilleur sens de la construction : ça palpite, ça cavale, avec des rebondissements, et des moments plus lents et plus majestueux. Le 4e mouvement, Allegro con brio, est enfiévré, avec un Daniel Harding toujours dansant, jusqu’à se lancer dans une forme d’escrime avec les violons, un orchestre désormais galvanisé, très à l’aise dans cette démonstration de force et de virtuosité. Les cordes se surpassent, c’est engagé, séduisant, énergique, avec une vraie vision et un beau déploiement dionysiaque. C’est bien la tempête sonore célébrée en son temps par Beethoven, ravi d’entendre un orchestre enfin fourni, répondant à son génie, dans cette « apothéose de la danse » tant vantée par Wagner. Le public ne s’y trompe pas, réservant un accueil triomphal à la phalange et à son chef.

Philippe Rosset
2 juillet 2023