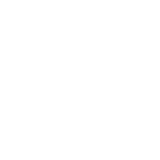Dans l’immensité du répertoire classique, certaines soirées semblent transcender la simple expérience du concert pour toucher à quelque chose de plus profond, un lieu où l’âme du compositeur rencontre celle de l’auditeur dans un échange silencieux et puissant. Ce fut le cas lors de cette soirée du 12 octobre au Victoria Hall de Genève qui vit se rencontrer Sibelius, Ligeti et Beethoven, trois géants aux esthétiques distinctes, mais unis par leur quête inlassable de vérité à travers la musique.

Sous la baguette inspirée de Hannu Lintu, l’Orchestre de la Suisse Romande est devenu le médium à travers lequel ces œuvres ont pris une nouvelle vie, vibrant d’une intensité qui semble prête à déborder de la scène. Dès les premières notes de l’œuvre patriotique de Sibelius, aux délires du Concerto pour violon de Ligeti, incarnés par la soliste extraordinaire Patricia Kopatchinskaya, jusqu’à l’éblouissant finale de la Septième Symphonie de Beethoven, cette soirée est une célébration de la musique non seulement comme art, mais comme force vitale. Un voyage à travers les époques, les styles, et les émotions, illustrant de façon éloquente la capacité de la musique à élever, défier et émouvoir profondément. Au-delà du simple concert, une expérience édifiante et cathartique.
Après l’immersion dans le patriotisme solennel de Finlandia, la scène se métamorphose en un paysage sonore étranger, presque extraterrestre, avec le Concerto pour Violon de György Ligeti. Cette œuvre, complexe et défiant toute classification, est un témoignage du génie d’un compositeur qui a repoussé les frontières non seulement de la musique mais de ce que nous percevons comme le réel et l’irréel. Patiemment élaboré au cours des années 1980 et 90, ce concerto symbolise la quintessence de la quête incessante de Ligeti pour l’innovation, intégrant des éléments de la musique traditionnelle, du modernisme, et même de l’illusion auditive.
L’œuvre s’ouvre de façon presque éthérée, avec un début qui évoque les paysages sonores de Sibelius, mais qui se transforme en une expérience auditive défiant la compréhension et les attentes. Patricia Kopatchinskaja, tout de rouge vêtue, incarne littéralement cette œuvre, au point d’en faire oublier le chef d’orchestre ! Son violon miaule, pleure, rit, dans un éventail d’expressions qui semble presque surhumain ; elle ensorcelle le public par son approche de la deuxième partie dans une révélation encore plus éprouvante, mêlant des sonorités orientales contemplatives avec l’utilisation inattendue d’ocarinas, transformant la scène en une méditation profonde sur le son et le silence.

Le violon chez elle n’est pas un instrument, c’est une extension de son propre corps, dépeignant une chorégraphie audacieuse de son et de mouvement. Le troisième mouvement exploite le registre suraigu du violon, créant un monde fantastique et capricieux, tandis que le quatrième offre un contraste stupéfiant avec une clarinette pianissimo qui évoque l’immensité et le mystère de l’espace. De loin, c’est le moment le plus passionnant de la soirée, pour son incroyable intensité physique et spirituelle, dans ces moments de temps suspendu où l’on sent que quelque chose d’impalpable se passe, créant une communion quasiment religieuse et hypnotique entre les musiciens et le public.
Plongée vertigineuse dans l’abysse sonore, ce quatrième mouvement, donc, éclate, défiant l’entendement, bouleversant les sens, arrachant l’auditeur à toute notion préconçue de réalité musicale. Là, dans un souffle à peine audible, une clarinette dévoile ses notes clandestines, évoquant un univers parallèle où la musique n’est plus séquence, mais essence. Nous ne sommes plus dans une salle de concert ; nous sommes aspirés dans un vortex sonore, un trou noir où le temps se distord et l’espace résonne. Les sons s’entrelacent, serpentent, se confrontent dans une danse cosmique, créant un labyrinthe auditif où chaque note est une étoile, chaque motif, une constellation. Ligeti nous tient en apesanteur dans ce fleuve statique, où les eaux ne coulent pas, mais vibrent, pulsent, émanent d’une source insondable. L’auditeur, privé de ses repères, n’a d’autre choix que de se laisser submerger, de se dissoudre dans cette immensité où résonnent les échos d’un univers inexploré. On ne peut s’empêcher de voir, par synesthésie un mystérieux monolithe noir surgir dans nos esprits, immense, impénétrable, reflétant notre image tordue par les ondes sonores. Cette néo-Odyssée de l’espace est la nôtre, intime, terrifiante, magnifique, magnétique. Kopatchinskaja, flamme écarlate, devient notre guide, notre prêtresse, notre fil d’Ariane dans ce dédale de résonances et de silences. Elle ne joue pas ; elle invoque. Son violon, prolongement de son âme, pleure, rit, hurle, chuchote. Soulages, maître de l’outrenoir, peintre de l’obscurité lumineuse, est là aussi. Chaque note est un pinceau trempé dans l’encre de l’infini, chaque phrase musicale une brosse qui caresse la toile de notre conscience. L’obscurité n’est pas absence de lumière ; elle est présence de mystère. Et dans ce mystère, Kopatchinskaja danse, virevolte, lutte et aime. Son archet est son partenaire, son adversaire, son amant. Le violon repousse les limites de ce qu’un instrument peut exprimer, de ce qu’un cœur peut ressentir. Des hauteurs cristallines aux abîmes grondants, il ne connaît pas de frontières, pas de tabous. Tout est permis, tout est nécessaire. L’audace de Ligeti rencontre la bravoure de Kopatchinskaja, et ensemble, ils nous offrent non une performance, mais un rite de passage.
Son jeu dans le cinquième mouvement devient chamanique, invoquant des images de transes dionysiaques, de forêts mexicaines, et même de rituels de sacrifice maya. C’est l’équivalent musical du « théâtre de la cruauté » dont parlait Artaud dans sa forme la plus pure, laissant le public pantois, haletant et extatique. Comment un violon peut-il produire de tels sons, de telles émotions ? C’est un délire de génie musical, culminant avec une virtuose littéralement possédée, sifflant et chantant tandis que l’orchestre simule une bataille chaotique. L’œuvre se conclut, laissant derrière elle un silence qui résonne plus fort que toute musique. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons voyagé au-delà des étoiles, plongé dans les profondeurs de notre être, confronté les fantômes de nos peurs et les démons de nos désirs. Patricia Kopatchinskaja accompagnée par les vaillants musiciens de l’OSR, ne nous a pas donné un concert. Elle nous a donné une renaissance. Indéniablement, une œuvre à voir, plus qu’à entendre.

Le bis est tout aussi généreux et captivant, avec Intermezzo, Giocoso-serioso et Nein ! démontrant la virtuosité de Patricia Kopatchinskaja, non seulement en tant qu’interprète mais aussi en tant que compositrice. Dialogue expérimental, livré avec l’un des premiers violoncelles, Lionel Cottet, impeccable et complice, cette pièce est le prolongement idéal du concerto. Le second bis, Ballade et danse pour deux violons, de Ligeti, mais plus sage, plus classique, rafraîchissant et virtuose, avec le concours de David Guerchovicth, musicien supplémentaire ne faisant pas partie de l’OSR, nous permet d’apprécier la belle générosité d’une artiste atypique.

Avec Ligeti, nous vivons une catharsis, une exploration des limites de la musique, de la sonorité, et de l’expérience humaine. C’est une démonstration que la musique n’est pas un art figé, mais un univers en expansion constante, défié et redéfini par des artistes courageux comme Patricia Kopatchinskaja. L’apothéose de la transe, en somme.
12 octobre 2023